Le roman de notre pensée
Jean-Philippe Domecq
Ce livre est le troisième d’un ensemble qui comprend :
1 – Histoire d’un homme
2 – Histoire d’un autre homme
3 – Le roman de notre pensée
à CdC
« Il y a quelques êtres humains
parmi les hommes. »
(Arnold Schönberg, rentrant d’un concert de huées, à Vienne)
novembre 2025
§1
 Que la vie vaille le détour !...tant qu’à vivre.
Que la vie vaille le détour !...tant qu’à vivre.
Sinon, on peut toujours survivre, sousvivre. On peut toujours l’échec existentiel. Seul échec, à vrai dire. Qu’est-ce que l’échec social à côté… ou, pire encore, « réussir »? Où peuvent bien passer ces regards d’autrui au regard de la mort ? Autrement tonique, si on ne l’oubliait sans cesse, imparable et net le tri entre nos plaisirs et nos peines qu’éclaire, face à nous depuis le début, le faisceau de savoir d’avance qu’on n’y sera plus un jour. Là, on voit. Pourquoi attendre la fin pour voir, quand on peut voir enfin tout du long ? Prodige !
Mais ce que j’en dis, n’est jamais que ce que je dis. Quand je pense quelque chose, je sais qu’il y a autre chose. (Ayons toujours cette voix-off à chaque pensée, chaque souffle)
Vivre ne se suffirait-il pas ? Faut-il toujours une vision qui nous aimante vers la version humaine de la vie ? L’humanité en a commis tant, de sens et de sens auxquels elle a cru tour à tour, qu’il y a de quoi renvoyer ce besoin au besoin d’illusions. D’ailleurs, aujourd’hui tout le monde semble en être revenu, et ça a l’air d’aller, l’Ambiance est aux « je » qui, chacun, prend son chacun pour monde. « Says I, To Myself, Says I », annonce pour demain le vernissage d’une grande galerie d’art international.
Lire la suite de cet épisode
Chacun son sens ? Si ce n’était là que contresens ; mais psychologiquement même c’est étouffant, pour « moi-même » (et « moi-m’aime », allez). Je n’ai jamais compris qu’onse contente d’être soi-même. Pourquoi se borner à ce point ? Ce point que je suis. Faire comme si de Rien n’était ? comme si nous ne pressentions tout ce qui n’est pas soi, en soi, hors de soi, hors de l’humain même ! Alors que nous ne sommes qu’humain, apparemment, apparemment. L’infini a été fait par et pour l’homme ; les chiens et les chats ont autre chose, ressentent la nuit sans bouger, de cela aussi nous n’avons pas (encore) idée mais nous interrogeons. Pour nous, vivre est en question, pas pour eux.
Le Tout-sauf-soi vient de nous et nous va comme l’énigme de vivre, partout tangible, à fleur de peau comme par-delà l’Univers depuis notre boîtier crânien. Il y a de quoi adhérer à ce vertige qui fait de notre laps d’existence individuelle l’exact bonheur.
§ 2
N’est-ce que moi, est-ce vous, est-ce tous que l’actuelle Ambiance étouffe ? Où est passée aujourd’hui l’aspiration à plus que soi ? Est-on seulement quelques-uns avec ça ?
On peut trouver cette interrogation vague et bien métaphysique. De toutes façons, à chaque temps ils trouvent et trouveront fumeux ce qui peut changer tout pour tous : l’Inconscient parut douteuse fumisterie viennoise dès 1901 ; fin 1788 les vieux et jeunes tenants de l’Ancien Régime (car il y a autant de jeunes qui sont vieux que de vieux qui sont jeunes, toujours) ne balayaient-ils pas d’un revers de « métaphysique » que le Tiers-Etat (la majorité du peuple) aspirât à être « quelque chose », et pourquoi pas avoir quelques droits proclamés « universels » ? Universels, au fait : c’est précisément ce qui s’oppose au chacun sans tous d’aujourd’hui ; universel s’est vu alors l’individu, plus libérateur et d’avenir que l’individu minimal du chacun son sens. Cette allusion de philosophie politique n’est pas si passéiste qu’on le croit provisoirement, ni particulièrement éloignée de notre besoin d’interroger la vie.
Nous pouvons tout à fait éprouver qu’il n’est rien de plus humainement réaliste que ce qui vaut métaphysiquement par la grâce de la mort d’emblée pré-vue. Mais, par une exception historique qui, pour le coup, invente le narcissisme historique d’une époque qui se croit sans commune mesure avec toutes autres, au XXIème siècle et depuis la fin du XXème l’individu n’aurait plus d’autre aspiration que la satisfaction de sa personnalité. La question du sens, portant par définition au-delà de soi, ne se poserait plus pour vivre. Mettons. Mettons que peu importe le sens que nous croyons alternativement bon de prendre. Sauf que la démarche humaine ne peut faire autrement que d’empêcher sa chute en mettant un pas devant l’autre, un sens après l’autre. Que l’on puisse à la rigueur se passer de sens mais pas d’aller de sens en sens, nous tient, nous tire en avant, et même parfois du lit, sinon, hein... On se demande bien. C’est l’intrigue, l’intrigue de toutes intrigues humaines, qui a pour suspens l’énigme à jamais énigme.
Du reste, à bien la considérer, l’histoire de la pensée a tout l’air d’un roman où les idées, sens et concepts se rencontrent et se confrontent tels des personnages, se croisent en situations, font figures, figurants, signes. Il n’est que de lire les philosophes : ils passent un à un sur la tête de leurs prédécesseurs, grâce à eux et ils sont les premiers à le reconnaître, disant que c’était fort bien, le prédécesseur, mais pas assez, il manquait ceci et cela, etc.
Eh bien, c’est l’heure du roman de notre pensée, pour qui cherche encore quelque motif de persister qui ne vaille pas que pour soi. Dans cette quête, la littérature est ce qu’il faut, elle seule ne ment pas puisqu’elle ne prétend jamais à vérité unique, elle ne livre d’explications qu’en situations – la vie même. D’un chapitre à l’autre, le roman de notre pensée se manifestera à plusieurs, à ceux que l’Ambiance étouffe. Autant dire qu’on sera peu, tout n’est que question d’appétence, quand on vit. C’est bon, on n’est toujours que Quelques à avoir l’appétence de transformer le monde intérieur, extérieur. Être seulement, n’est pas être seul.
§ 3
décembre 2025
Les « Quelques », donc.
Ce fut d’abord « les Quelques-uns », il y a de cela une douzaine d’années, un peu plus. On trouve aussi la variante des « Quelques-unes et uns » dans leur correspondance – où, soit dit pour donner idée, les courriels d’invite aux réunions saluent le groupe moins souvent par « Chers » que par « Chères », générique au féminin jamais usité seul jusqu’alors en langue française, ni peut-être en toute langue.
Pourquoi ce nom, les « Quelques-uns » ? Pourquoi ce groupe ? Était-ce même un groupe ? Et que devint-il ? Que devient-il et deviendra ? On a envie de savoir, de voir !... Qui verra vivra, n’est-ce pas. « Tant qu’à vivre », autant l’aventure. Aventure = ce qui advient. En discernant bien on peut faire advenir, de dessin à dessein se transforment l’homme et le monde. « La croissance de l’homme ne s’effectue pas de bas en haut, mais de l’intérieur vers l’extérieur », observait Kafka.
Lire la suite de cet épisode
Les Quelques-uns c’est cela, à l’origine. Autour d’une table analogue à celle où chacun écrivait et continue en ces temps, croiser les regards pour discerner à plusieurs mieux que seuls. Sachant que la solitude ne manque jamais. Nous avons deux solitudes en nous. L’essentielle : se sentir lancé là-dedans, la vie, et comprendre qu’on ne fait qu’y passer, comme s’il n’y avait que la vie et la mort d’ailleurs, certains pensent même qu’on « transite », mais bon, pas besoin d’atténuer le vertige, gardons cette solitude sans filet, c’est la bonne, l’inquiète et propulsive, on ne peut plus réelle. Et il y a la sociale, périphérique solitude prise entre les rideaux de fumée d’opinions, néfaste celle-là, quand on ne sait plus jusqu’où douter contre soi-même, quand on se demande « Suis-je seul à voir cela, suis-je sot ou fou pour ne pas comprendre ce que tant de mes semblables ont l’air d’admettre ? ». La plupart s’en accommodent, s’adonnent au quant à soi. Pas tous. Qui partage ce doute ? Je parle du doute plus fort que soi, si minant et puissant à la fois qu’il peut susciter chez certains, pour ne pas dire quelques-uns, une quête vague, livrée à ce qu’on nomme un peu vite le hasard mais qui peut aimanter ce qu’on nommera beaucoup moins vite « les affinités électives » (roman plus libertaire qu’on l’attendrait de ce génie du juste milieu en tyroliennes qu’était Goethe). Les leurres ambiants s’écartent dès qu’on entend quelqu’un se murmurer à lui-même : « je me disais bien aussi… que quelque chose ne va pas ». Oui, cela arrive, c’est tout à fait possible d’entendre exactement qui l’on doit entendre de l’intérieur, en son silence. Alors la solitude devient objectivante, elle perd son aliénant pouvoir de confusion. De là s’opère la bifurcation entre n’être que seul et Etre seulement, l’adverbe prenant un sens actif qu’il n’a pas d’ordinaire.
Ce n’est que le plus exotérique des cercles d’affinités, au point d’être d’abord tacite, mais il est nécessaire pour que quelques-uns se repèrent les uns les autres à une même impression d’époque. Ce qu’elle est et n’est pas. La camper, celle-là, pour y faire advenir plus qu’elle : et qu’éventuellement cela attire plus de quelques-uns, de cercle en cercle toujours plus concentriques autour de la Table-plus-que-ronde.
Il y avait besoin, plus que besoin aux premiers temps du XXIème siècle. Mais, avant le contexte, dissipons toute illusion morale : de même que la solitude est ce qui manque le moins, de même la proportion des réfractaires à l’aliénation est-elle constamment minoritaire. C’est d’ailleurs encourageant, au vu des progrès de l’Histoire. Nul élitisme social dans le constat. L’appellation de Quelques-uns nous est venue parce que sans ambiguïté ; elle évacue l’élitisme de classe, de culture ou d’argent, qui ont force de domination et de reproduction conservatrices. On ne voit pas que les privilégiés soient l’élite qu’ils prétendent. Mais s’ils tiennent à parler d’élite, alors oui, les Quelques-uns ce serait à la républicaine, l’élite pour causes publiques, élective par révolte affirmative, sans révoltisme, par appel d’air, besoin d’écarter les limites. Voilà pourquoi c’est sans illusion sur le nombre. En toute société, la minorité transformatrice ne dépasse pas les 30%, répartis en tous milieux, paysans, institutrices, employés de banque, commis d’administration, serruriers de supermarché, gérants de laveries automatiques, camionneurs (il y en eut plus à cacher des Juifs que d’auteurs de la NRF, si si, la NRF de Drieu fut interdite de 1945 à 55), mannequins, garçons coiffeurs, commissaires-priseurs, chefs du protocole, de rayon, de gare, directrices d’école, de compagnies d’assurances : 30%. 30% maximum – beaucoup moins chez les auteurs français, avec eux on est dans les 3%, ou les Suisses tenez (souvenons-nous de Mars, de Fritz Zorn, conscient dans sa chair que son cancer est intériorisation de l’incurable neutralité suisse - j’ajoute : de toute neutralité). Illustrons, et tout le monde s’accordera sur ma petite théorie des minoritaires agissant : les 30 % de Quelques-uns de tout temps donnèrent les Résistants, les lecteurs des Lumières, les dissidents d’URSS, les Justes pour les Juifs, les Socialistes à la Jaurès ou Blum, les blancs américains tabassés aux cotés des noirs au temps de Martin Luther King, les mâles aux côtés des femmes manifestant pour la contraception, etc, etc. Les Surréalistes furent 30, les Situationnistes aussi à peu près, les Apôtres douze. On est toujours peu avec la liberté, la justice, avec le grand désir, la chercheuse inquiétude humaine.
La lancée des Quelques-uns tombait bien, en plein moment aveugle. En ce temps-là, le nôtre, la mélancolie de vivre s’était renouvelée au point de passer inaperçue, donc d’être aisément refoulée. Quand je disais qu’il ne s’agit que de « bien discerner ». Et pour cause paradoxale : la mélancolie était devenue nostalgie de l’avenir. L’avenir avait très longtemps été religieux, téléologie théologique, puis historique à partir de la Révolution française et de là tendant vers toujours plus et mieux de justice, l’égalité, les émancipations. Mais, en 1991, au motif que » l’avenir d’une illusion » communiste s’effondrait heureusement avec le Mur de Berlin, quel avenir a remplacé l’autre à l’horizon radieux de l’Histoire ? Un demi-corniaud philosophe prophétisa « la fin de l’Histoire », s’esbaudissant que, le communisme effondré, le Marché couronnerait la démocratie, enfin ! Tout l’effort humain dans les siècles et les siècles, y compris la lutte contre le totalitarisme, pour aboutir au commerce mondial des biens et services… L’argent allait tout bouffer, évidemment. Déjà qu’il est hors-loi par fluidité et par puissance de notre avidité réflexe, déjà qu’il avait toujours été nécessité et passion, si en outre la richesse devenait mérite personnel et perspective collective… Toutes les valeurs et l’avenir y passeraient. A la fin du vingt-et-unième siècle c’en était fait, les opinions avaient incroyablement oublié que l’argent atteint tout si on le laisse faire. On ne pensa plus rien pour maîtriser cet outil des outils. On a vu depuis. L’argent « libéré » comme jamais confirme que les affaires n’ont que faire du libre individu, au contraire. Les libertés collectives de chacun furent repoussées au point de ne plus savoir ce que c’est que les libertés collectives de chacun ; les libertés individuelles purent être rabattues sur les libertés narcissiques, l’idéologie du psychologisme. Un siècle après la Grande Dépression, la Grande Régression psychique des années 20 du XXIème siècle emporte, dans un reflux où c’est la vulgarité qui invente, tout ce qui avait été conquis par desseins et luttes en émancipations, égalités, justesse dans la justice, pouvoir civilisationnel de la culture.
§ 4
Pression poétique
Dureté des temps ou pas, tout se joue toujours par les mots. Si je rappelle cette évidence, elle n’est pas à entendre comme une de ces professions de foi poétique devenues un des classiques de l’espérance d’avant-garde. J’entends et admets qu’il y a aussi, en prenant le mot dans son sens d’innovation de langage, une poétique de la vulgarité, une poétique de l’intérêt, de la bêtise argumentée, du mensonge, de la mauvaise foi. C’est pénible à dire, mais la créativité des oppresseurs sait être formidable, à la pointe des nouvelles vagues. Sinon, ils ne soulèveraient pas les foules ni ne seraient portés par l’opinion populaire. Que « le » réel, le leur à côté de tous autres réels, soit façonné par le verbe, les conservateurs ne le savent certainement pas moins que les progressistes. Pour conserver, on ne peut se contenter de reproduire la vulgate dont on hérite, il faut l’assortir, la renouveler comme la mode. Si l’on n’a pas trop peur de la lucidité, l’année où je me décide à écrire ce roman de pensée, l’année 2025, nous démontre comme jamais, homme le plus puissant de la planète en tête, que la politique la plus immorale s’impose par la grâce épaisse d’une transgression verbale révolutionnaire en ce qu’elle recule les limites de la vulgarité dé-civilisatrice. Comme quoi, la transgression n’est pas qu’une joie surréaliste ; j’avoue n’avoir jamais été trop convaincu par les théories de tortures transgressives à la Georges Bataille (flamboyant romantique du sexe, à côté de ça). Le vingt-et-unième siècle en tout cas nous lègue ceci quant au pouvoir des mots : le travail de vérité a pu être congédié par une addiction au mensonge qui fait jubiler l’opinion populaire et la voue à une régression mentale dont elle se repaît plus que de besoin. Pour un temps. Pour un temps, peut-être, mais cela se jouera à peu, si cela doit, peu face à beaucoup. Le peu, en pourcentage de consciences et d’appétences, ne laisse pas d’autre choix que d’être extrêmement qualitatif face au règne du quantitatif comme signe des temps.
C’est ici qu’interviennent les Quelques-uns, s’ils le « pveulent ». Ce verbe, qui fait partie de leur dictionnaire spontanément inventé, désigne l’indissoluble réciprocité entre vouloir et pouvoir. Soit dit en passant et en mettant en circulation ce mot-valise, les Quelques-unes-et-uns furent bien conscients d’ôter pas mal de patientèle aux psychanalystes. « Je n’ai pas pu venir hier, excuse-moi.
- Tu n’as pas pu.
- Pas pu.
- Tu n’as pas pu venir, ni prévenir.
- Oui, parce que c’est au dernier moment que je n’ai pas pu.
- Au dernier moment, oui, je comprends.
- (…)
- Je voulais venir mais finalement j’avais autre chose.
- Ah, autre chose.
- Autre chose, oui. Je suis libre, après tout.
- Ah, libre.
- J’ai ma vie, non ?
-Ah, ça.
- (…)
- Oh et puis quoi, il faut admettre la liberté de chacun !
- Oh celle-là, on ne fait que ça.
- Pourquoi, il y en a une autre ?
- Tu poses la question. La prochaine fois, ne dis que tu ne pveux » [1]
Etc, on connaît...
Ceux qui parmi les Quelques-uns n’ont pas douté du pouvoir des mots – et on doit jouer particulièrement fin de nos jours - ont donc fait leur pari, tant qu’à vivre. Le pari fut d’opérer la Pression poétique. La poésie est ce qui, par son absence de règles a priori et de méthodologie productive, nourrit latéralement l’expérimentation que les autres discours d’intelligence du monde, avec tout leur apport et leur nécessité, ne peuvent s’accorder par eux-mêmes. Sur eux il y a moyen de faire pression indirecte, par réfraction de pensée, par ce biais de point de vue qui seul révèle le grain du mur, biais au sens où les villageois d’autrefois disaient d’un des leurs « il a le biais » parce qu’il trouvait moyen de tout réparer. La poétique comme nouvelle donne de formulation fait faire à l’esprit ce pas de côté qui révèle des portes à l'intuition en sciences humaines, astrophysique aussi bien, économie, éthique, politique même. Si volatile soit-elle, et parce qu’elle l’est, en assumant, la formule de « pression poétique » est adéquate par épure. L’heure en effet n’est plus à « la beauté convulsive » du surréalisme, mais, nos temps étant plus pervers, à certaine beauté d’exactitude.
On va comprendre comment ce nous est apparu, par de premiers extraits de nos correspondances. En post-scriptum à un de nos courriels, je répondais à Valérie Rossignol ceci : « Oui, la signature est librairie s’est magiquement passée, comme si l’esprit chamanique et de meute (vous savez mon amour pour les loups, animal politique solidaire s’il en est, et qui ferait vraiment souhaiter à l’homme qu’il soit enfin « un loup pour l’homme », et ne surtout pas souhaiter au loup qu’il soit homme pour le loup !... ) le tour d’esprit lancé lors du Bref et aussi Mondial Happening [2] se poursuivait presque de lui-même. Les jeunes gens qu’il draine sont venus en bande, une vraie descente, ça a marché tout seul. Mon idée (de jeune homme) de faire pression poétique sur le monde, pour réamorcer la pompe de tous les discours et actes sur le monde tel qu’il pourrait changer, semble prendre tournure… Cela vous concerne et je vous implique au plus haut point, c’est affaire de gouvernement…de l’extérieur par l’intérieur. »
Fin du courriel de réponse de Valérie Rossignol : …« En ce qui concerne mon projet, je rêve moi aussi de faire pression poétique sur le monde, afin que le monde prenne conscience que le seul espace à reconquérir est intérieur.
Mais je suis bien seule.
On continue peut-être, mais selon quelle loi ? »
C’était en 2014. Prochain épisode en conséquence : Politique de la poétique… et lèvres molles.
(D’ici-là, en annexes, premières esquisses d’annonce qui devait être publique des Quelques-Uns, en 2014, passée sous silence.)
[1] Dictionnaire des mots manquants, page 62 – 63, éditions Thierry Marchaisse, 2016.
[2] Cf. Bref Happening mondial, Total Ready Made, sur YouTube et paru aux éditions Tituli, en vente en ligne chez cet éditeur, Paris 2014.
Janvier 2026
§ 5
Politique de la poétique,
au temps des lèvres molles
« Le poids précis de l’univers, l’humiliation, la joie. »
(J-L. Borges)
Je sais bien qu’il est de mode et commode de faire sa moue de maturité avertie au seul mot de « politique ». Je sais bien que le mot indisposera plus encore si je l’accole au mot de « poétique. Eh bien, tant pis pour ceux qui voient dans le poétique un doux et réservé domaine. La politique de la poétique, c’est ne pas en rester là, jamais ; c’est avoir besoin de plus que tout ce qu’on imagine, pense et ressent seul. Il faut à chacun son langage et que celui-ci passe à l’Autre, ou l’on en reste là.
Ce ne sera pas la première fois que la création individuelle s’enrichit de la création collective et celle-ci de celle-là ; je suis reconnaissant à toutes les poignées d’êtres qui par la culture ont à eux seuls transmis leur belle audace de vivre, entre eux, au-delà d’eux, et dans la suite des temps.
La « pression poétique » fut peut-être la formule de chimie mentale que l’entité des Quelques-Uns invitait à exercer stratégiquement sur l’Ambiance culturelle française. Je dis « peut-être » alors qu’elle le fut assurément pour quelques-uns parmi les Quelques-Uns, d’emblée. Pas pour tous, à ce qui s’avèrera plus tard. - Attention, ceci n’est pas une allusion aux visiteurs de passage. Encore que… pourquoi ne pas en parler tout de suite ? Hein... Croquer vite fait les ombres et profils fameux ou non qui défilèrent entre et sur les murs de l’appartement ancien où se réunissait la compagnie, pourquoi ne pas !... Nous sommes dans un roman de la pensée, non ? Dans la vie aussi, d’ailleurs.
Lire la suite de cet épisode
Des visiteurs de passage, il y en eut au fil des ans, et pas qu’un peu – tellement que d’aucuns se sont retrouvés les soirs de liesse entre mur et télé à celle-ci accoudés, le surplomb que ça donne sur les débats… (ceci juste pour dire). Nombreux les « De passage », donc, qui s’invitaient à jeter un œil – comme on dit sans mesurer ce qu’on dit – sur ce qui pouvait bien se tramer autour de l’improbable Table-plus-que-ronde dont l’occulte rumeur distillait vers le Toutout-Paris l’envie sociale d’en être avant les autres, qui fait le sel du pré-snobisme. Ce fut bien le seul « isme », au demeurant, dont un des Quelques-Uns se targua et défia l’« ismisme » d’avant-garde, boutade de courriel qui aurait dû suffire à confirmer que notre mouvement nouveau ne reproduirait pas le modèle des mouvements nouveaux du passé. Mais bon, à ceux qui ne pveulent pas comprendre, il est vain d’expliquer : soit qu’ils sont bouchés (voilà pour le « peut » dans le pveut), soit qu’ils ont intérêt à en rester là (c’est le « veulent », qui sonne bien, du pveulent). A ce genre d’indices on aurait dû pressentir les bornes, et moins longtemps tolérer la compression que les engoncés malins ont opposée à la pression poétique. Mettons-nous à leur place : pour « réussir », il ne faut pas que cela bouge autour des marches chèrement gravies. Ceux qui montent au mérite fournissent au manège contemporain de la société ce qu’il faut pour préserver son mécanisme d’ascension. Voltaire au moins souriait au Seigneur qu’il croisait sur le palier : « Vous descendez, je monte ». Arriviste s’il en fut, Voltaire n’hésita jamais à foutre en l’air ses savantes courtisaneries pour « écraser l’infâme » intolérance.
Toujours est-il que les défilants curieux ne sont pas passés à côté de l’aventure qui bruissait à la Table-plus-que-ronde de ce groupe étrange. Ils en sortaient amusés, et stimulés. Stimulés pas plus de vingt-quatre heures sans doute, mais c’est déjà ça. D’une part nos défilants s’avouaient, en bas de l’immeuble à minuit imaginez : « mais… qu’est-ce qu’on est libres à cette table ! ». Ce qui, entre nous, dit de Paris quelque chose que l’on n’aurait pas dit en des temps autrement oppressants, les années 30 par exemple, ou autrement entraînants, les années 60. D’autre part et surtout, nos visiteurs n’avaient pu manquer d’observer certaine rutilance de culot parmi les couverts ; et aussi cette faconde de liberté critique qui donnait au rire son littéral éclat, et, à la voisine du dessous et aux étudiants du dessus, le désir de sonner à ce théâtre. Nos visiteurs d’occasion, qui ne sont pas naïfs, craignant de l’être, sortaient de là épatés, pour une fois en ces temps. Enfin quoi, fallait-il que ces « Quelques-Uns » fussent gonflés tout de même, barrés complètement, barges ou pire : idéalistes – ce qu’à Dieu ou Rien ne plaise ! –, pour croire qu’une politique de la poétique, si affutée soit-elle, puisse modifier quoi que ce soit aux mentalités et, plus encore, au couvercle culturel français, si policé, n’est-ce pas.
Précisément c’était, et c’est la raison de plus, supérieure - et folle, selon les lèvres molles, qui pensent bien à demi -, raison pertinemment folle de parier que c’est possible, parce que sinon… Sinon, on a vu depuis.
Non que nous concevions la littérature comme mode d’action. Ses liens avec la société ne sont jamais voulus directement dans les œuvres qui font vivre ; c’est même pour cette raison, parce qu’elles ne l’ont pas cherché, qu’elles modifient les mœurs. Une œuvre de conquête érotique remue le corps social, en sous-main si l’on me permet, plus profondément qu’une œuvre combative. En attendant Godot de Beckett fait toujours bien dans la bouche d’un ministre ou d’un envoyé spécial très spécial de dictateur russe, alors que le très sûr Sartre déclarait à propos de cette pièce que c’était pas mal, Beckett, mais que peu après il avait vu à Moscou une pièce soviétique sur une grève en usine et ça c’était autre chose !... Nous en avons discuté un soir, de la littérature engagée à la Sartre, qui ne fut jamais en reste de coups de talon rhétoriques comme on les aime en France et pas seulement chez les auteurs collaborateurs ; ce fut un de nos nombreux échantillons de réévaluation souhaitable, la réception de Sartre restant encore laudative en vertu de la tradition française de s’incliner devant ses grandes figures littéraires arrivées. Cela fait partie des chantiers qui auraient pu être lancés dans une revue à créer ou des tribunes collectives, si des lèvres molles n’avaient trouvé que c’était aller « trop loin ». Nous pourrions revenir, dans un chapitre, sur le roman national littéraire très particulier de ce pays.
La pression des mots libère d’oppressions pas seulement par la frappe de notre discernement critique mais aussi par la pression inventive de nos créations. Pourquoi choisir entre le travail du positif et celui du négatif, dialectiquement ? La poétique que nous mettons en œuvre était et est en constellation expansive, comme on le verra, et c’est déjà tout vu si on se donnait la peine de nous avoir lus. Les œuvres sont là, en fait d’ouverture sensible et spirituelle, d’abandon poétique, de vie vue d’ailleurs, de ce que « rien n’est banal au monde, tout dépend du regard », etc, etc. Quant au climat des soirées à Quelques-Unes-et-Uns, il fut hautement festif, table à la Molière, j’y tiens, à ce qui s’appelle « faire la vie » !
Mais alors, pourquoi le lancinant « peut-être » par quoi commença ce chapitre ? Que s’est-il passé, au fond ?
Très au fond, une bonne raison, d’abord. Nous étions partis sans a priori aucun. Le mouvement des Quelques-Uns n’avait pas formulé de « pression poétique » à l’origine, rien défini par manifeste ni par écrit ni de quelque manière que ce soit. Cela demeurera une de ses originalités historiques. Nous sommes assez instruits par l’Histoire, le temps n’est plus aux obédiences esthétiques unilatérales comme au XXème siècle. Pour autant, si notre indéfinition initiale traduisait un discernement du moment où nous sommes, cela n’enlevait rien à la pression du désir, au contraire. Au fond, cette histoire de « pression poétique » revient à ce qu’énonce Freud : « Si on cède sur les mots, on finit par céder sur les choses ».
L’Ambiance dans laquelle naquit ce mouvement, n’a fait que le confirmer. Je dis « l’Ambiance » comme Balzac mit majuscule à « Rente », toutes lourdeurs égales d’ailleurs dirait la mathématique de la servitude, qui pour se perpétuer régulièrement s’améliore, comme la bêtise grâce aux progrès de l’intelligence.
Nous avons commencé à nous réunir vers 2013 tandis que la foire aux vanités littéraires, à force de logique médieuse et de narcissisme libéral qui va très bien avec, devait se lâcher dans une systématique psychologisation de toutes opinions. Comment discuter si ce que je dis n’est entendu qu’en tant que mon opinion, ma subjectivité, « ton histoire personnelle », typique phrase de lèvres molles ? L’aimable bêtise épuise, d’où ses victoires.
Il n’y eut pas de résistance. Pas de… pression qualitative (je ne parle pas de mes écrits sur la bêtise cultivée puisqu’on n’en parle pas : puisqu’ils m’ont valu liste noire : puisque cela fait peur). La peur de dire quelque chose contre l’oppression culturelle, cela existe comme cela a existé, faut-il le rappeler ? Il le faut et cela se paie. La peur et la coercition par « mort sans phrase » (plus d’articles sur ce que vous écrivez, mise à l’écart éditorial, etc, on n’imagine pas que cela se passe dans la culture, plus que dans l’économie ou la politique), ont endurci l’arrivisme sélect, qui a libéré la vulgarité qui, ne se rendant de compte à soi-même ni de rien, ignore la peur. Pour résumer à grands traits en ce début de manifeste ouvert (pour la première fois dans l’Histoire : ouvert à qui pveut, non prescrit par un seul), tout le monde admet maintenant, mais un peu tard, que la révolution réactionnaire n’a pas eu peur des mots, elle. Elle joue même à fond de la transgression que l’intelligentsia de gauche croyait réservée à la philosophie érotique de Georges Bataille. Dans le relâchez-tout dont il n’a donné que le ton que ses fadas prennent pour du style, le romancier idéologique Michel Houllebecq a ouvert les vannes à ce qu’il m’a fallu nommer l’école du « Glauquisme ». Le glauque serait le fond du vrai. S’il suffisait d’être cynique pour être réaliste…[1]. Cet écrivain a, parmi ses opinions d’anguille poisseuse, exprimé sa faveur pour Trump, plus carnavalesque que lui dans l’audace vulgaire. Houellebecq n’est qu’un symptôme mais il a libéré les pulsions préalables aux idéologues aboyeurs dont se lamentent ceux-là mêmes qui l’ont promu comme des abrutis. De la Grande Régression intellectuelle des années 10 et 20 du XXIème siècle, plus précisément : de la Révolution de l‘Inintelligence qui caractérise l’actuelle rupture de valeurs, le spectacle littéraire français et le niveau de ses débats auront été l’avant-garde qui s’ignore, annonciatrice à sa petite façon et de longtemps. On y et en reviendra.
Mais, détendons-nous…
Il y a un peu de fantastique dans ce roman, oh pas grand-chose, mais qui lève un coin du voile sur le bizarre passage des Quelques-Uns aux Quelques. On a appris une chose, à l’usage, du haut étage où ils se réunissent. D’ordinaire, « l’esprit de l’escalier » c’est la répartie qu’on trouve trop tard, après la discussion ; mais là, force a été de constater que cet escalier-ci ne donne de l’esprit qu’en montant, pas en descendant. Si on avait su !... Il y avait des bouchés volontaires et des lèvres molles dans ce groupe, certes, on l’a assez compris, mais ce n’était peut-être pas lacune d’esprit de leur part s’ils ont fait inertie.
Et puis ceci aussi, tant qu’on y est : l’étage étant haut, l’appartement fut baptisé la « Tour-d’y-voir-venir », donnant sur la plus grande gare d’Europe, par la même fenêtre sur laquelle s’ouvre Hugo Cabret, le film que Martin Scorsese a consacré à Méliès. Comme quoi, et sans crier gare, vient d’être assurée ce qu’il faut bien nommer, en style de roman, la situation. A présent, le suspense de la pensée peut revenir à ce « peut-être » en suspens sur nos têtes depuis le début du chapitre.
Si on a écarté celles des arrivants d’occasion, quelles têtes ont bloqué l’aspiration poétique ? Le blocage vint de la majorité de permanents initiaux, là est la surprise, sans qu’il y ait de raison d’être déçu, on n’avait qu’à voir avant. Les lèvres molles distillèrent le sémillant dissolvant du scepticisme. On a toujours l’air fin quand on toise mondainement celui qui aspire à autre chose. Maintenant, pourquoi l’obstruction corrosive, une petite énergie si négative, insidieusement dévalorisante de tout ce qui pourrait dépasser la prudence tactique ? La réponse est dans leur inertie assumée : ils trouvaient que c’était ambition que de vouloir autre chose, ils raisonnaient donc en termes d’ambition personnelle. Ils tenaient à ce que ça ne sorte pas de la Tour-d’y-voir-venir.
Ça… ? Pendant ces années, neuf ans, ce fut le gai savoir, du tonique créé véritablement. Nul ne démentira jamais que je me suis constamment voulu garant qu’un tour d’esprit de bienveillante exigence impulse chaque soirée, chaque débat, généralement improvisé tant nous avions écoute et répondant. Soirées à approfondir avec Frédéric Joly sa biographie littéraire et politique de Robert Musil ; soirées sur la poésie, sur Borges, Pessoa, Michaux, dont une particulièrement joyeuse et tardive avec Jacques Réda pour ouvrir l’année 2017, où nous ne savions pas que l’une d’entre nous, Anne Dufourmantelle, nous quitterait tragiquement à l’été. Soirée avec l’éditeur et le traducteur de l’œuvre complète de Philip Larkin, dont un vers d’une métaphysique suprêmement évidée nous est devenu viatique en fin de courriels :
« Nothing, like something
Happens anywhere ».
« Rien, comme quelque chose
Arrive n’importe où ».
Un des fils rouges de nos réflexions demeurant le langage, il devait advenir que l’un d’entre nous en dise long, via Robert Antelme et Marguerite Duras, sur le soi-disant silence des déportés du retour des Camps alors que non, ils voulaient parler, mais sans écoute. La psychanalyse, bien sûr, souvent ; l’actualité cinématographique, beaucoup, certaines séquences de films antérieurs faisant office de nouvelle sorte d’apéritif, onirique, entraînant. Traversée des événements, attentats, première élection de Trump, pandémie, l’apolitisme très politique du « en même temps » en toute perversité acceptée par les bien-pensants ; souhait d’intégrer à la réflexion politique la responsabilisation des peuples électeurs ; eau tiède du Nobel attribué à Modiano après Le Clézio et avant Ernaux, ce qui, en fourchette de quelques années, fait l’incontestable habileté gallimardienne. Publication de deux romans retrouvés de Céline par le même éditeur pas plus gêné que sa NRF pendant la guerre, sous les bravos de l’intelligentsia de gauche y compris – il faudra décidément en reparler, ici qu’on est libre sans éditeur, parce qu’elle influence et révèle l’Ambiance, cette tradition de veulerie littéraire. Mais d’abord, pour comprendre ce qui va se passer, lecteur, sache que nous préférions parler, nous autres, du Guerre et Paix contemporain que fut la trilogie Ton visage demain, de Javier Marias ; de 2666 et des Détectives sauvages de Roberto Bolaño, de ses chroniques critiques qui n’avaient pas françaisement la trouille de discerner. Nous ne parlions pas de Houellebecq, Angot, Beigbeder, ni du Spectacle présentant comme « intellectuels » des médieux comme Onfray après BHL et autres. Ceci vite expédié ici pour rappeler qu’a contrario le travail du positif, la compagnie des Quelques-Uns l’a plus qu’accompli, proposé, de l’avis de tous les participants. Mais, mais chaque fois qu’il fut question de sortir cette créativité de la Table-plus-ronde, de manifester publiquement la nuance critique de jugement et l’amplitude de désirs que l’Ambiance du temps a étouffées au point de la censurer par autocensure conséquente : chaque fois une majorité des Quelques-Unes-et-Uns a stratégiquement bloqué.
C’est à n’y pas croire, la compagnie s’est révélée poreuse à l’individualisme concurrentiel qui sature la société contemporaine. C’est entré jusqu’à nous. Ils et elles venaient là mais gardaient à l’esprit de ne pas compromettre les carrières dans un milieu parisien qui ne pardonne rien et permet beaucoup moins que le milieu politique, contrairement à ce que croit l’opinion commune. Le narcissisme psychologisant a tellement miné toute valeur, qu’il a fallu entendre qu’il était narcissique de vouloir manifester publiquement le point de vue des Quelques-Uns, à la manière par exemple dont Camus et Max-Pol Fouchet à vingt ans créèrent une revue pour résister – ne serait-ce que cela ! L’argument dissuasif de « l’ego » proféré par qui se foutait bien que Quelques-Uns fassent Quelque chose, laisse un je ne sais quoi de typique dans les souvenirs.
Peu à peu, par effet conjugué de frein sourd et d’émollientes mignardises, la pression poétique, qui naît de ne pas pouvoir se contenter de soi, de sa seule vie, du « il en sera toujours ainsi », passa sous silence, attentive à tous mais écœurée par la peur qu’avaient les autres de se faire mal voir du milieu. Au fond, ces fins s’en foutaient, de toute pression poétique. Mais le taisaient d’un air entendu ; il vous vient, les observant, des croquis et notions : Paris réussit aux fins-lourds (= se trouvent légers) et aigres-fins (= se trouvent rebelles). Comme il n’était pas question d’exclure à la mode surréaliste et situationniste – ce qui n’empêcha évidemment pas la mauvaise foi des lèvres molles de le dire, dissuasion d’après-coup peut toujours servir - mais qu’il n’était pas plus question de confondre tolérance et indifférence bon teint, il fallut bien que se disjoignent le cercle proche du moyeu immobile qui fait tourner, et le cercle plus exotérique de ceux qui venaient là comme ça.
On avait pourtant proposé et dessiné un révolutionnaire modèle de groupe culturel permettant d’embrayer les uns aux autres plusieurs rythmes plus ou moins engageants et plusieurs sous-ensembles en cercles : le Différentiel. Cette grande roue ingénieuse que nous voulions tôt et pouvons enfin appliquer à tout groupe d’invention civilisationnelle, méritera son épisode prochain dans ce feuilleton, à présent que cela s’est ouvert sur le monde.
Puisque le Différentiel en sa souplesse fut quand même refusé par malins et malines, ce fut logiquement qu’arriva, au bout de neuf ans, la passation des Quelques-Uns aux Quelques. Filtrage, divergence ou séparation, scission si l’on veut.
C’est fini tout ça. Finis les grands désirs et la tonique inquiétude, l’heure est à l’hystérie des modérés, à la tolérance noyée dans les eaux tièdes de l’indifférence et du calcul de soi.
§ 6
Le Congrès de Hambourg
Je me suis laissé dire, ou raconter, que dans la période où la boxe était la plus populaire aux Etats-Unis, à un moment les trucages s’étaient tellement généralisés que, plus un match n’étant faussé, les parieurs commençaient à ne plus savoir qui valait qui et quoi. En conséquence, les mafieux et bookmakers qui tenaient le marché se réunirent en conclave et décidèrent d’organiser, en hiver avant l’ouverture de la saison des rings, une semaine de combats à huis clos en Europe, à Hambourg, où ils firent venir en avion et s’affronter les champions qui étaient considérés comme les meilleurs avant que la corruption n’eût brouillé toute évaluation. De ce séjour entre hôtels et matches secrets, ils revinrent aux Etats-Unis avec leurs calepins annotés selon un classement sérieusement étalonné qui, le temps que le naturel humain revienne au galop, laissait un répit de paris non truqués.
J’aime cette histoire. Pas seulement parce qu’elle est de juteuse logique ; mais aussi parce qu’elle fait rêver. On me voit venir, n’est-ce pas, rêver de cette histoire de paris à Paris, un bon congrès, n’est-ce pas, où « Quelques-uns » ou « Quelques », je dis ça comme ça, donneraient rendez-vous sur scène dans un théâtre deux à trois soirs de suite par an, un show, du Broadway comme n’avaient pas peur d’en administrer les Ginsberg, Ferlingetti, Burroughs, de la Beat Generation en tournées dans leur vieille Chevrolet d’une université à l’autre, et l’on discuterait librement, très publiquement, ostensiblement, jovialement, rigoureusement, jubilatoirement, drôlement, analytiquement, honnêtement, férocement, intelligemment, finement surtout, finement enfin (je peux vous aligner comme ça les adverbes à la Artaud si vous voulez – vous n’y tenez pas ?), de ce qui a été promu par presse et médias dans l’année, et même depuis des années, vu le stock ! de littérature et idées françaises. Bien entendu et tout comme dans la boxe, le « quelque chose de pourri au royaume » des coteries reviendrait au jeu parisien, mais entretemps on aurait quelques années inoubliables qui par la suite pourraient être invoquées et culpabiliser quelque peu, puisque ce milieu et aucun milieu ne sont pas capables de tenue par eux-mêmes. Le Congrès pourrait s’intituler « Comédie de la critique ! », avec le point d’exclamation inclus dans le titre (forcément), cette fiesta annuelle faisant bilan de Critique de la critique… Et en effet, pourquoi la critique culturelle serait-elle seule au-dessus de toute critique ? Y aurait-il prêtrise ?
Quoi ? Des cris, là-bas… Oh la clameur… Tout de suite les hauts cris, j’entends d’ici... ! Croyez-moi, il est funeste et vain, en libre culture, de dire les choses, de dire, par exemple, que…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(prochain épisode : le Grand Différentiel, et la veulerie littéraire française)
[1] A qui pensera qu’une parenthèse est expéditive pour un si mûr point de vue, proposons de consulter les deux tribunes parues dans Le Monde, accessibles directement sur ce site www.lescorpscelestes.fr , onglet du livre en cours « De l’Ambiance littéraire ». Ainsi que la seule critique de la « littérature » et de l’encensement pro-Houellebecq dès ses débuts, dans La Situation des esprits, 2003.
Février 2026,
§7
L’intuition,
et le Différentiel, prototype de nouvelle créativité collective
Il y a quelques années de cela, mon sérieux journal consacrait une page à un projet de laboratoire d’idées dépassant l’échelle des think tanks habituels qui se définissent par leur champ d’application circonscrit (économie sociale, améliorations de la démocratie, programmes et perspectives politiques…); il s’agissait cette fois d’élaborer la ou les nouvelles interprétations générales de l’homme et du monde susceptibles d’éclairer l’avenir, en regroupant les personnalités les plus avancées dans les principaux domaines de recherche de par le monde. L’idée même de ce think tank suprême paraît historiquement naïve. Comme si les mutations qui ont changé notre vision universelle n’étaient pas nées d’un individu, Galilée, Newton, Darwin, le Christ, Freud, Marx, Keynes, Einstein, porté certes par l’état d’esprit contemporain mais seul à avoir fait le saut novateur, par une disposition personnelle forcément imprévisible. Même du Christ historique, qu’on le tienne pour fils de Dieu ou pour fils de l’Humanité, il n’y a rien d’iconoclaste à dire que, sans certains ingrédients particuliers de sa psychologie, il n’y aurait pas eu de Christianisme ni la mutation qu’il a opérée pour l’humanité.
Dans la même période des années 2010, un autre programme de réflexion universelle avait de quoi susciter la perplexité mais avec une interrogation plus productive sur le ressort profond de la créativité mentale. L’UNESCO a mené d’abondants travaux qui sont probablement les plus approfondis sur ce qu’est l’intuition, son fonctionnement, son apport, plus que tout ce que la philosophie, la psychologie et la science ont pu en dire depuis l’aube des temps. L’enjeu est considérable si l’intuition est la faculté décisive d’invention et découverte. L’une des conclusions tirées de ces recherches de l’UNESCO est qu’il faudrait introduire l’enseignement de l’intuition en université puis dans les programmes d’éducation générale. Là se glisse la perplexité. N’y a-t-il pas contradiction dans les termes, indépassable paradoxe à vouloir enseigner ce qui échappe à toute logique prédéterminée ? L’intuition n’a pas et n’aura jamais son Discours de la méthode. Elle nous vient on ne sait comment, par on ne sait plus ce que l’on sait, vers autre chose qu’on va soudain voir puis savoir.
Charles Fourier, socialiste critico-utopique selon Marx et Engels, élabora en détail un nouveau monde amoureux, industriel, agricole, en se donnant « l’écart absolu » pour moyen de recul par rapport aux savoirs acquis et systèmes entérinés. « Avoir le biais », disent les villages, j’en parlais au début, le biais de point de vue, d’angle mental qui révèle le grain du mur qu’on a toujours trop vu pour le voir. Quelque chose comme l’optique sans organe.
Longtemps après avoir écrit Robespierre, derniers temps, récit enquête historique marqué par L’Affaire Mattei, film de Francesco Rosi dont j’avais admiré et tiré la « poétique du politique » (une des acceptions de la poétique proposée ci-avant), j’ai essayé de comprendre si ou comment j’avais pu, sur un événement tant étudié, moi simple écrivain, apporter quelque chose qui ne soit pas « faire de la littérature avec l’Histoire », genre que je ne lis jamais parce qu’il affaiblit le suspense de « l’effet de réel » que certifie par contre la rigueur des ouvrages d’histoire. J’avais tenu le plus grand compte des conseils et travaux des historiens de la nouvelle école française sur la Révolution française, et la publication de mon livre fut plutôt bien accueillie par les spécialistes. Comparé et croisé à leur compétence, mon apport éventuel n’avait pu être que d’éclairage et non de connaissances supplémentaires ; alors, m’était-il venu de l’intuition littéraire, si quelque chose de la sorte existe ? Grâce à une postface que m’a commanditée l’éditeur Eric Vigne pour rééditer le livre, la curiosité qu’aiguise l’auto-interrogation me porta à lire ce que je pouvais sur l’intuition en tous domaines, y compris scientifique ; et, l’écriture m’amenant toujours à penser mieux que ce que je pense, cela a donné plus qu’une postface : un essai à part entière, La littérature comme acupuncture, pour tirer au clair mon indéfinie façon de faire parmi les « Voies de l’intuition » [1] : « C’est embarrassant, l’intuition. Elle passe communément pour parente pauvre des démarches de l’esprit, la culture européenne ayant privilégié la raison. Maint philosophe de cette culture n’en fait pas moins découler celle-ci de l’intuition. Qui fournit le postulat des doctrines aussi bien rationalistes que mystiques. Pascal, quant à lui, ne stipulait-il pas que les principes géométriques venaient du cœur et non de la raison ? » Au fait, je conseille son Traité du Vide aux amateurs de Zen pascalien ; ils y trouveront, heureusement, des tableaux chiffrés de « Différences d’un lieu à l’autre » (pour « quand l’air est chargé »… bien entendu). Cela qui me rappelle un tableau de classe où le professeur de maths avait laissé quelques équations sous l’énoncé de l’exercice : « Calculez la longueur annuelle moyenne des ombres des arbres en France ».
Puisque nous en étions à notre janséniste, il n’est peut-être pas mauvais, bien que vain dans l’ambiante envie que rien ne bouge pour monter dans la carrière culturelle -, vain mais tant pis ! de rappeler que « Pascal, cet effrayant génie » dixit Chateaubriand, composa ses Pensées exactement en même temps que ses polémiques Provinciales. D’une même main la frappe et la grâce. Dans le « vide de ces espaces infinis » où paraissent plus vaines qu’elles-mêmes les prudences de tant d’ego stratèges qui réussissent pour réussir, le combat d’idées et la grâce d’esprit sont simultanément compatibles. D’une compatibilité qui peut être recommandable. Il faut être fort attaché à la société telle qu’elle reste pour ne concevoir point que notre esprit peut se consacrer au positif et au négatif en même temps ; peut-être même le doit-on quand les temps le requièrent ; peut-être même est-ce très bon et ne diminue point l’approfondi dans chacune des deux voies, au contraire. Les têtes molles aux lèvres pareilles n’ont pas idée de la vie forte, dégagée. D’où leur cliché qu’il vaut mieux être positif, c’est tellement plus joli, généreux, moral, pour ne pas dire : c’est moins risqué. Le grand bourgeois culturel garde sa hauteur de vue.
Le balisage des différentes « voies de l’intuition », si l’on envisage la littérature comme acupuncture, inclut les « récents travaux en sciences cognitives qui ne tracent plus l’intuition parmi les processus mineurs ou collatéraux de l’intelligence », et concernant les sciences dures, ceci : « Pour la plus exacte de ces sciences par exemple, si l’intuition mathématique garde quelque chose de constant, c’est de changer constamment de paradigme ». L’intuition semble l’infime bascule à surpuissant effet. Tout ce qui peut en être analysé revenant toujours à ne pas pouvoir saisir l’intuition (a fortiori l’enseigner), une méthode sans méthode pourrait lui être adéquate : « à échelle expérimentale nous gagnons en clarté si, pour chaque intuition misée en tel ou tel domaine, nous mettons sur la table la conception que nous nous faisons de l’intuition – autrement dit : notre intuition de l’intuition. » Il fallait en conséquence soumettre à appréciation celle qu’expérimenta l’écriture de Robespierre, derniers temps : « Mon intuition de l’intuition est, pour le dire ainsi, que celle-ci est l’imagination de la pensée ; la raison sans la méthode mais sans quoi la raison manquerait de tête chercheuse. L’intuition procéderait d’un pas de côté par rapport à la logique occupante, ce qui donne les possibilités suivantes », etc.
Ces « possibilités », les discussions des Quelques-Uns puis des Quelques tourneront souvent autour. C’était prévisible, d’ailleurs prévu dans les pages de La littérature comme acupuncture : « Du passé de l’histoire de la pensée donc, retenons a minima que, puisque l’articulation et la hiérarchie entre nos facultés mentales se reconfigurent périodiquement avec le temps, l’intuition en connaîtra évidemment bien d’autres. A savoir, quant à l’avenir ? De l’état présent de cette même histoire de la pensée, on peut tirer que l’intuition pourrait prochainement être majorée, recentrée. »
Le lecteur et moi ne nous étonnons pas de retrouver d’analogues formulations d’un livre antérieur et dans le présent feuilleton : la pensée a bien sa narration. La mienne du moins. Prenons-moi et nous pour échantillon.
Pas étonnant que la continuité de pensée autour de l’intuition créatrice se soit poursuivie à la table de discussion des Quelques-Uns puis des Quelques, et désormais via le « Manifeste ouvert » ici - ouvert à qui le pveut, à qui veut et voudra poursuivre, on le redit pour confirmer que l’intuition constitue une de nos propositions publiques d’exploration.
Un groupe littéraire n’est pas le plus mal placé pour cela. Les groupes culturels ont été, et sont peut-être les seuls avec les laboratoires scientifiques, à mettre en œuvre une créativité collective plus intuitive que tout rêve de suprême think tank. Et pourquoi ? Parce que toute création culturelle, sous toutes ses formes et sur tous supports, nait de l’intuition. L’intuition individuelle du créateur.
Le salon des Lumières fut un accélérateur de particules intellectuelles dont l’Encyclopédie, création collective, n’est pas le seul résultat mais tout autant les créations individuelles de Diderot, Rousseau, tous. Même laboratoire d’idées dans le salon de Madame de Staël puisque Napoléon, en bon Empereur, l’exila. Autour du critique et penseur d’art Clement Greenberg, les peintres américains se réunissaient et transitaient d’un atelier à l’autre avec l’émulsion qui dans leurs toiles explose encore all over. Au XIXème siècle, Delescluze après chaque soirée en son salon notait surtout et bizarrement, de ce qui s’était dit, les provocations amusées du moins connu d’entre eux, Stendhal, qui giclait l’ironie voltairienne lorsque la conversation se pâmait en romantisme chateaubrianesque et se rengorgeait de vapeurs romantiques lorsqu’elle tournait sèche. Et puis évidemment, le surréalisme a constitué un groupe si démultiplicateur qu’il a changé la donne culturelle du siècle, en une poignée d’artistes et poètes. Les situationnistes ensuite, le Grand Jeu, etc.
En lançant le groupe des Quelques-Uns, il ne s’agissait pas de reprendre ces modèles ni quelque modèle que ce soit ; mais, tout de même, nul ne peut ignorer l’émulation collective en culture.
Il se trouve pourtant que l’entreprise - au sens générique où les Lumières employait ce mot - s’est retrouvée lestée. Les freins, étonnants, sourds mais fermes, obligèrent à comprendre que l’Ambiance, sous la chappe idéologique du libéralisme-ultra qui avait répandu l’individualisme concurrentiel, pesait plus lourd qu’on aurait pu l‘augurer de cultivés. Ce que j’ai rappelé vite au premier épisode, le « chacun sans l’autre », imbibe complètement le milieu centralisé de la culture française. (Qui, soit dit en passant, ose s’étonner que le progressisme politique soit en déshérences d’idées...) Le quant à soi règne farouche, fier de soi, revendiqué avec nerf sans avoir rien à envier au « bien quoi je suis libre ! », libre quasi à la libertarienne conservatrice américaine pourtant critiquée par ceux-là mêmes. Un quant à soi très quant à soi. Se réunir une fois le mois est trop, quand le faire deux fois par semaine au café surréaliste ou à Vienne ou Prague du temps de Kafka allait de soi. Et puis, il ne fallait surtout rien divulguer ni publier de ce que nous approfondissions ensemble. Sans parler de la tremblante des lèvres molles ourlées de bien-pensance à l’évocation d’André Breton ou Guy Debord dont elles retiennent avant tout qu’ils ont exclu. Pourquoi pas pleurnicher sur les saloperies politiques et facilités esthétiques d’Aragon, Eluard, Dali – il faudra revenir, tenez, sur pourquoi Breton et cette race de phares-emmerdeurs sont si mal vus de nos jours.
Pour ne pas nous tromper d’époque, nous autres, il nous fallait trouver moyen de faire tourner malgré tout ensemble ces désirs différents, les très-quant-à-soi et ceux qui ont mieux à foutre. Une occasion par « le biais » du hasard se présenta. Je l’exposais aux Quelques-Unes-et-Uns (mail du 10 décembre 2017 : …« l'année 2018 pourrait être une année où celles et ceux qui le pveulent feront des choses, à Quelques-Uns d'entre les Quelques-Uns, selon le schéma de liberté individualiste à tout crin (époque anti-individualisme universaliste des Lumières oblige) que nous avions esquissé il y a trois ans sur le modèle du différentiel d'Onésiphore Pecqueur qui permet aux roues de rester en engrenage sans tourner au même rythme (pour les nouveaux Arrivants je joins en copie le Booklet Pecqueur qu'une entreprise d'horlogerie m'avait commandité, et que les Quelques-Uns d'alors connaissent déjà). Autrement dit, faire des choses Dehors. D'où mon Jugement de Hambourg mystérieusement annoncé mais que je n'ai pu vous expliquer l'autre fois. » La correspondance générale du groupe est ponctuée par cette proposition révolutionnaire et réaliste de modèle d’articulation collective qui articulerait, éviterait que divergent et tournent sur eux-mêmes les rythmes ego-grégaires de l’individualisme privatif. Cet extrait, de juin 2015, parce qu’est citée une trouvaille de Victor Hugo : « …Différentiel inventé par un grand algébriste, O. Pecqueur, qui, de l’algèbre à l’horlogerie puis l’automobile, laquelle n’aurait pu exister sans ce système, permit d’embrayer deux roues qui ne tournent pas à la même vitesse en virage. Cela pourrait donner le schéma de deux groupes à l’intérieur de « nous-mêmes », les Quelques-Uns et les Quelques-Autres. C’est un écho également à la citation de Hugo que nous a livrée Christian, où on lit que l’avenir dépend de « quelques-uns » (sic) , pour constituer « la foule suprême ».
Avec le rituel dyptique photo de cette fois, Salut et Fraternité, amis »
A présent, le fonctionnement en Différentiel est en expansion, élargi, embrayant maintes roues/personnes existantes et futures. Chaque époque ayant ses maux et moyens nouveaux, le site numérique qui publie ce Manifeste permet de nous relier en tous points et sources, en village comme à Paris, Londres, et Kiev où des poètes d’entre nos Quelques sont partis, nous parlent et écrivent sous les bombes.
Et, en tous domaines, politique, scientifique, économique, social, astrophysique pourquoi pas, ce modèle sera applicable.
Ainsi la boucle n’est pas bouclée mais démultipliée par connexions dont nous-mêmes n’avons pas idée… mais intuition.
§8
"C'était l'heure déjà où tourne le désir."
Une des nombreuses occurrences du Différentiel de la correspondance numérique est ici délivrée parce que le lecteur y pressentira le moment, critique et inquiet, de bascule qui mène des Quelques-Uns aux Quelques deux ans plus tard, puis à la libération dynamique d’aujourd’hui et demain.
Mail, 13 mars 2020 à 15:47:16 UTC+1
De : Jean-Philippe Domecq
Objet : "C'était l'heure déjà où tourne le désir." (Dante)
Chèr/es vous tous,
Nombre d'entre vous ont exprimé le souhait que reprennent les réunions des Quelques-Uns. Notre Table-plus-que-ronde est donc bien celle de tous, et c'est de tout cœur que je vous propose de nous retrouver, ceux qui le pveulent, le mercredi 8 avril prochain. Nous conviendrons des dates suivantes chaque fois ensemble ainsi que nous l'avons toujours fait.
Nous ne sommes pas réunis depuis le 30 novembre. Ce soir-là, les projets d'expression publiquement underground lancés la fois précédente n'avaient pas à être abordés puisque leurs initiatrice/eurs finalement n'ont pu venir. De toute façon, des voix et des silences s'étaient exprimés dans notre correspondance informatique pour écarter a priori ces projets ; la soirée l'a confirmé, puis s'est achevée dans ce sens. A la question que j'avais suggérée par courriel l'avant-veille pour remplacer la discussion sur l'action poétique (:"Qu'est-ce que les Quelques-Uns ? Aspirent-ils à devenir Quelque chose ? Ou tout autre chose. Ou l'Autre chose. Disons les choses"), nous nous sommes quittés sur la réponse, déjà entendue, que les Quelques-Uns c'était des soirées qui nous réunissaient pour parler de littérature autour d'une table. Cette réponse n'a pas fait peur ?... Si c'est toute l'aventure que nous avons partagée en sept ans, j'ai failli m'excuser. Non. Nous ne parlons pas de littérature en lecteurs passifs, mais créateurs, chacun/e selon son mode de création (dernière création en date : le livre de Philippe – Garnier – qu'Amélie vient de publier en ses éditions Premier Parallèle, est né chez nous ; nous reparlerons de cette Mélancolie du pot de yaourt). Deuxièmement, la littérature qui nous réunit n'est pas la littérature pour la littérature, mais la littérature vive, qui parle donc de tout. De fait, ensemble nous avons parlé de tout : de politique, de sexualité, du merveilleux de nos jours, de cinéma (d'où la photo, tirée de L’arrangement de Kazan, que je vous joins pour saluer notre regretté Kirk), de Wittgenstein et du dandysme féminin de Juliette Gréco, d'angoisse devant les périls historiques nouveaux, de la Culture contre la culture que produit la fine fleur littéraire française depuis vingt ans, de psychanalyse, de poésie, de "Rien comme quelque chose arrive n'importe où", du Vide aussi bien – de tout.
Quant à ce que les Quelques-Uns se manifestent publiquement sous une forme ou sous d'autres pour exprimer à l'occasion une vision qui ouvre le temps, on craint le leadership mais on attend toujours la création collective de ce groupe. Pour ne prendre qu'un exemple parmi des milliers, est-ce seulement par “ego” qu'Albert Camus et Max-Pol Fouchet ont créé une revue poétique de résistance en 1940 à Alger ? Les temps que nous vivons sont-ils à ce point reposants que l'on s'en trouve bien comme ça? J'entends bien que le désir d'intervenir ponctuellement pour changer un tant soit peu la vie à partir du levier d'Archimède que constitue le langage inventif, passe désormais pour état d'âme personnel ou volonté de puissance individuelle… ; mais ça, c'est "leur morale et la nôtre", titrait Trotsky. En sept ans, nous avons évité tous les écueils des groupes culturels du précédent siècle, en sept ans il n'y eut ni commandement d'un seul, ni obédience esthétique ou idéologique imposée, nulle fermeture à quelque sujet que ce soit, il y eut liberté démultipliée les uns par les autres et décisions toujours démocratiquement prises. Résultat… : nous nous sommes toujours rangés à l'absence de volonté générale.
Il y a mieux. En inventant un nouveau prototype culturel, en ce moment de l'histoire où nous sommes instruits des dérives de la logique groupusculaire (qui, au demeurant, a beaucoup donné à vivre ; le Surréalisme par exemple). C'est dans cette optique que je vous ai souvent soumis le modèle du Différentiel, qui permet, autour du même moyeu (ce moyeu est dans notre cas l'acquis de nos forts et fins échanges et des affinités électives qui nous unissent), de conjuguer les différents rythmes des uns et des autres, ceux qui n'éprouvent pas le besoin d'action poétique et ceux qui l'éprouvent, en toute liberté réciproque dans un cas comme dans l'autre. J'avais d'ailleurs pris soin de vous reparler, en ouverture de notre soirée le 30 novembre (je vous transmettrai plus tard l'enregistrement du début de soirée, qui constitue un document dans l'histoire de notre groupe [2]), de cette invention du Différentiel, géniale de subtilité technique : transposée à la culture et aux groupes humains, cela n'a jamais été fait et peut constituer une des nouveautés qu'apporte notre groupe.
Désormais, des expressions publiques des Quelques-Uns auront lieu, sous une forme ou sous une autre, inventée selon les désirs et moments. Il n'y a pas lieu de craindre que nous signions de temps en temps une tribune, que nous fassions circuler le magnétisme des Quelques-Uns lors d'événements publics, sur scène, en librairie, en galeries, en boîte de nuit, et de jour aussi d'ailleurs tant qu'on y est; via aussi la nouvelle liberté offerte par internet sans les contraintes ni la régularité d'une revue imprimée, et toutes autres initiatives au fil de nos désirs et des opportunités que présentent les difficultés du monde.
De toute façon, quoi ? Y a-t-il une vie avant la mort, c'est la question. Or il n'y a guère de vie sans horizon, sans l'aimantation qu'entraîne l'horizon – sans aventure. Aventure = ce qui advient !... Quel suspense, vivre.
Au plaisir de vous revoir, chèr/es vous tous, Salut et Fraternité !
§9
Ce qui résulte d’une soirée européenne en temps menaçants
D’emblée, la réunion de ce mois-ci fut dans l’esprit originel des Quelques. Les Quelques c’est aussi cela, tout y recommence toujours en recommençant autrement. Les conditions techniques n’étaient pourtant pas données : la liaison en visio-conférence serait-elle possible entre Kiev, bombardée ou pas cette nuit-là, Londres et Paris ? Sur les murs ou dans nos tempes, certaines ombres étirées du Troisième homme en noir et blanc ont dû courir en ondes. Les sept visages apparurent sur nos écrans, nous rapprochant les uns des autres dans le cadre. Les trois qui étaient à Kiev, David di Nota et le couple Anne et Laurent Massart que nous retrouvions après bien des correspondances et leurs textes sur la guerre d’agression publiés en revue Esprit depuis deux ans, avaient la ferme décontraction de ceux qui en ont beaucoup vu chaque jour, deuils, destructions, courage, vie. Tous trois sont partis en Ukraine « pour voir et comprendre », alors qu’ils n’avaient aucune attache ukrainienne ni raison personnelle de quitter la France, où ils étaient bien. Partis dans le feu pour « examiner » par eux-mêmes, a confirmé Olivia de Resenterra notre interlocutrice londonienne elle aussi auteure, compagne de David. Entre Londres et Kiev, David envoie des billets sur réseaux et textes d’une écriture imparable qui frappe au cœur tout à la fois des livraisons d’armes et d’une pensée géopolitique débusquant à la verticale les onctuosités « réalistes » et dérapages du toujours renouvelé ventre mou. Y aller, explique Olivia, pour trouver l’écriture qui à la fois décrira et pensera spécifiquement cela d’inouï. Et, confirmé par Sophie Képès venue à notre Table-plus-que-ronde, qui a parlé d’expérience, ayant écrit et publié au temps du siège de Sarajevo, nous avons vite débouché sur la particularité inaliénable de cette affaire étrange qu’est la littérature : aller vers ce qui échappe, là où ça se passe. Là où il faut trouver le langage qui n’y est pas encore. Or, ce même langage est devenu un enjeu national pour les citoyens et pour les auteurs et artistes dont Olivia, David, Anne, Laurent récoltent la parole (moisson d’avenir). Le Russe, auparavant langue nationale avec l’Ukrainien, n’est plus langue maternelle à l’intérieur de soi ; avec tout ce que cela suppose comme torsion intime. Des écrivains, en l’occurrence nos Quelques interlocuteurs, ne sont peut-être pas mal placés pour appréhender cette déchirure pas seulement linguistique, qui confirme qu’une langue est patrie plus profonde que toute terre.
Et que nous apprennent nos amis « d’Ukraine » ? Que la poésie se démultiplie comme jamais dans le pays en guerre, dans une émulsion culturelle qui touche toutes les catégories de citoyens et d’expression. Danse, théâtre, concerts, revues numériques. Avec grandes lectures publiques où se pressent les soldats, qui plébiscitent tel poème comme à un concours, et dans les tranchées ils discutent tel choix verbal à telle place du poème plutôt qu’à tel autre…
Pourquoi nous a pris, en entendant cela qui nous parvient de sous les frappes russes, une très paradoxale paix morale ? J’ai été épuisé de soulagement dans la nuit. Pour tant de raisons. L’après-coup de la réflexion qui suit la séance de visio-dialogue a fait réentendre ce qui fut dit, et, oui, le violent apaisement en nous vient de ce que ce qui nous fut dit, nous confirmait ce que nous avons toujours misé contre vents et marées d’Ambiance. Je réentends… : la littérature ? Le besoin de voir et comprendre, indissolublement ; le senti et pensé. C'est la littérature qui peut motiver à "y aller", sous les frappes. Et en retour la réponse des Ukrainiens, des soldats discutent les poèmes aussi tangiblement qu'ils discutent d’armes pour se libérer.
Voilà, on se disait bien aussi que "le signe ascendant" est tout ce qu'il y a de réaliste. Un des chantiers à proposer est : redéfinir le/les réalisme/s. En tous domaines, économique aussi bien que littéraire, social, géopolitique ; l'heure est à cela. Les réflexions et descriptions d'hier soir le confirmaient : il n'y a rien de plus réaliste que de regarder la vie depuis notre conscience de la mort. Sophie l’a développé par des exemples et ce qu’elle en a tiré : la guerre à Sarajevo soulevait les gens « au-dessus d’eux-mêmes » - même si, après-guerre, ils retrouvent leur étiage… Qu'il faille la guerre pour que les humains sortent de leurs limites individualistes n'est pas admissible pour la "chasse au bonheur". Il "suffit" de se rappeler la mort pour élargir la vie, quotidiennement renaître. "Le" réalisme est bien métaphysique, ou n'est qu'une version des réalismes. Notre époque a cela au présent comme en perspective ; la guerre d'Ukraine en ce sens marque, outre la Naissance d'une Nation, un retour à l'essentiel, au tonique vertige d'exister en le sachant.
Une tache de notre époque, l’éveil métaphysique : l’évidence toujours refoulée pourrait ne plus l’être, pour notre bonheur.
(La force de ces choses repousse le chapitre sur la turpitude littéraire française qui avait été annoncé en février à la prochaine fois, entre autres)
[1] Robespierre, derniers temps, réédition de 2011, suivie de La littérature comme acupuncture, p. 351 à 355, Folio-histoire, Gallimard.
[2] Désormais audible via le lien « Une soirée des Quelques-Uns », du 30/11/2019, dans : www.leblogdedomecq.bogspot.com
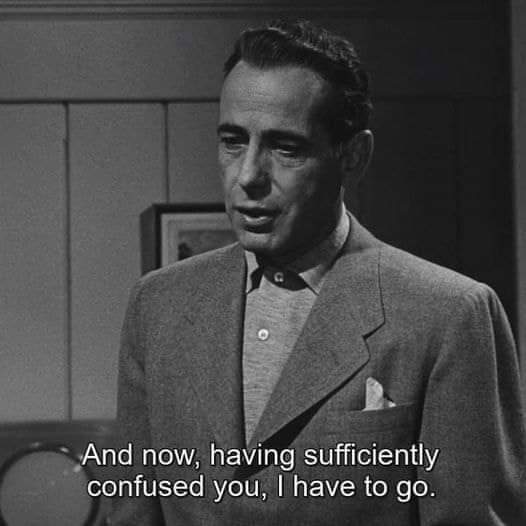

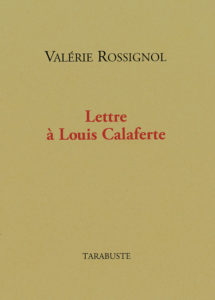
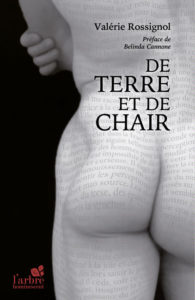

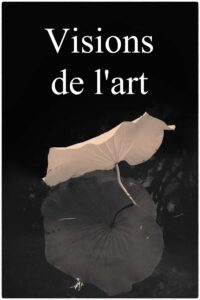
"la démarche humaine ne peut faire autrement que d’empêcher sa chute en mettant un pas devant l’autre, un sens après l’autre." C'est exactement cela et cette phrase, admirable, pourrait éclairer ceux qui ne me comprennent pas lorsque j'ai écrit "C'est la terre qui marche sous mes pas".
Oui, Colette Klein, cette sensation existentielle que "c'est la terre qui marche sous mes pas", est le "peut-être", littéralement, qui nous fait humain dans cet univers, éperdûment. J'ai aussi toujours eu la sensation qu'autour de mes pas, de mes semelles même, "le vide est notre seul appui". Ce vertige n'est pas négatif, au contraire. A condition d'y adhérer. Ce n'est pas le gouffre qui nous donne le vertige, mais de voir en même temps notre chaussure à côté.
Jean-Philippe Domecq
Jamais seul! j'ai marché, je marche ce jour, voire demain, avec mon ombre; ou est-ce l'inverse ? fidèlement accouplée à mes pas elle s'étire au gré d'un soleil couchant quand mon moi doute et se restreint face à cette dualité.
En écho à Harry Le Ret: .. et, plus souvent qu'à ton tour, tu regardes ton ombre te regarder, au sol.
Parfois c'est à deux, sur le chemin. Il serait intéressant de voir aussi ce que ça donne si plusieurs, en compagnie, se surprennent ainsi, sur une place.
Belle réflexion Jean-Philippe. Oui, la pensée est un roman en cours. Et vous terminez par cette phrase magnifique : être seul, n'est pas être seul.C’est peut-être là le cœur : exister pleinement, avec désir, avec cette volonté de transformer le monde rapproche de ceux qui suivent le même chemin.
à Marianne Ginesta: Exactement, Marianne, de la poétique exactitude que nous donnent tels de vos posts faisant de réseaux sociaux bons messagers à qui sait se repérer les uns les autres. Exactement vous le dites: c'est une question de "désir", d'appétit, si Quelques-unes et uns ont voulu et veulent faire pression poétique sur le monde pour le transformer, y compris dans ses contigences. On continue!...
Ah, mais oui c'est tout cela ! Refractants qui cheminent d'incidence en incidence, chaque pas pour lumière : une théorie d'equilibristes et ce vertige qu'il te donne à les voir à contre noir. En fond, la menace et l'aboie de leur chasse
à Ferrière Marzio : "d'incidence en incidence", oui, c'est ainsi que se fraie tout chemin d'affinités. Et comment, aimanté par quoi? Par le vertige de se retrouver là, en ce monde - l'appétence vient de là, qui creuse le désir infini.
"mais le vide de la route même, une image toujours échappée, jusqu'à ce que la tête lui tourne." Avant cela, Henri Thomas écrit : "Horreur des plaintes, des pleureuses, et fascination du désespoir qui n'est que ceci, la route tournante, le mur de la chapelle dont toutes les pierres sont visibles, le virage toujours repris, lentement, attentivement, brusquement en sens inverse." Le goût de l'eternel
à Catherine Ferrière Marzio: ah oui, vous faites bien de convier à rouvrir Henri Thomas. Ce "vide de la route même", que vous pointez, est bien dans la démarche métaphysique, nécessairement métaphysique, de ce temps-ci qu'invoque et appelle le prélude de notre "manifeste ouvert". Ajoutons cette "route tournante, le mur de la chapelle dont toutes les pierres sont visibles"...: lumière de rêve, accrue, que j'essaie justement de capter dans mes actuels "paysages inextérieurs".
...à propos de la parenthèse sur le loup dans mon courriel à Valérie Rossignol, précisons, cela ne fera pas de mal à l'humain : L'organisation socio-politique des meutes de loups intéresse les récents chercheurs et philosophes parce qu'ils ont constaté: que le mâle protège la femelle et la mère, les forts protègent les vieux et les petits, les faibles. Pour un peu le loup serait animal "de gauche"... Les conservateurs américains, au bon temps du maccarthysme, ne s'y trompaient d'ailleurs pas qui lançaient des campagnes de battues massives en faisant du loup une incarnation du "communisme".
Le loup est en train de regagner les contrées du conte, las d'être mal aimé au point d'être "prélevé" comme il se dit entre exploitants et décideurs frileux et apeurés devant la révolte tracticole. Pour ma part tant qu'à dire je serai de sa traîne avec les ceux qui le suivront ! C'est un voyage et rude comme une vie ! Ça va vers le sombre qui guette et accueille, mais ça va, ça ira, ça ira, en compagnie ! Loup devant !