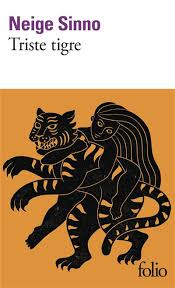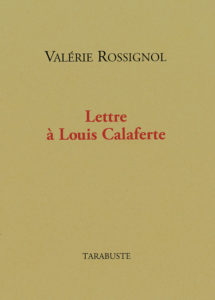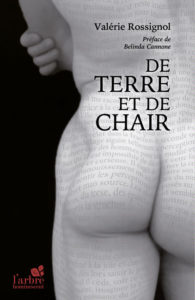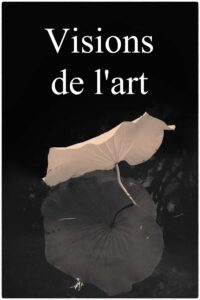Lettre à Neige Sinno
Neige,
C’est une nécessité intérieure qui me pousse à vous écrire, longuement.
J’étais à une réunion du groupe littéraire Les Quelques, que nous organisons Jean-Philippe Domecq et moi-même tous les mois à Paris, quand une amie cite votre livre Triste tigre que je n’avais pas lu. J’ai alors suivi son conseil et vous ai lue.
Je suis sculptrice, écrivain et lectrice, enseignante en collège aussi, et je connais la problématique de l’inceste pour l’avoir héritée de ma mère. Je vais convoquer ces différentes facettes de mon existence pour vous écrire, tant votre récit soulève en moi une réflexion et des approfondissements que je voudrais partager. Et, comme je sais que ce qu’on se dit là nous dépasse, je vous écris et m’adresse aussi à chaque être qui souhaiterait cheminer avec nous.
D’abord, je dois vous avouer que je suis une lectrice en quête d’œuvres littéraires fortes, et que j’ai lu une partie de votre livre, en me demandant, comme à chaque ouvrage que je lis, si c’était un texte « littéraire », et, je le reconnais, pendant un moment, je l’ai lu comme un témoignage. Sans doute que la question du style y était pour quelque chose. Je me sentais embarquée dans une écriture lapidaire, peut-être un peu expéditive, très informative. Je m’attendais en somme à lire un témoignage dans la lignée du Consentement de Vanessa Springora. Il est difficile par ailleurs de faire une œuvre littéraire avec cela. Stéphane Lambert y parvient, selon moi, dans L’Apocalypse heureuse, ouvrage que j’ai défendu; Ian Mc Ewan aussi, dans Leçons. Christine Angot, dans Inceste, en revanche, échoue dans la mesure où elle ne parvient pas à objectiver sa situation mais au contraire écrit avec une violence qui empêche le lecteur de se responsabiliser. Elle nous noie, reproduit le schéma du viol. Son livre m’a été très pénible à lire. On ne peut pas rendre compte de la violence en usant des mêmes armes qu’elle. On n’écrit pas pour détruire ou contaminer son lecteur mais pour lui faire comprendre quelque chose et l’édifier. C’est un postulat de départ auquel je tiens, un filtre qui me permet d’ouvrir le champ et de sortir du « glauquisme » dans lequel notre époque se complaît parfois.
Et donc, j’ai compris votre doute : « Comment écrire quelque chose de neuf, d’esthétiquement valable si on est écrasé par le sujet ? » Et pourtant, au bout d’un certain temps, aux deux tiers du livre, vous m’avez impressionnée. J’ai commencé à comprendre qu’il n’était plus aussi évident pour moi de considérer votre livre comme un simple témoignage. Je vous ai suivie et vous m’avez emmenée loin. Vous avez réussi à porter haut la torche, éclairant les angles morts à votre passage. Je ne saurais expliquer cela, tant vous mettez à nu tous les aspects de votre expérience, révélant les tenants et les aboutissants ; les effets produits du viol sur vous, sur les autres. Le ton, surtout, change. Vous prenez chair dans votre écriture, la voix que vous appelez le « ton bravache » se nuance, se précise et s’élève. Votre conscience a tellement passé au crible des dimensions variées de l’existence : la mémoire, les sensations, l’amitié, la notion du mal, les causes, les conséquences, la responsabilité, individuelle, collective, vous avez tellement arpenté le gouffre que le souffle se libère. A ce stade avancé de ma lecture, j’ai été convaincue que vous aviez écrit un livre immense et salvateur. Un peu comme le témoignage Mars, de Fritz Zorn. Quelques pages plus tard, vous avez écrit ceci qui rejoignait mon constat : « Le témoignage est un outil d’analyse, mais un outil bien affûté arrive jusqu’à l’os. Et quand on touche l’os, l’art n’est jamais loin. » Pour revenir à mon propos initial sur le choix de votre écriture, j’en arrive à la conclusion que votre ouvrage, autobiographie, témoignage, essai ?, ne pouvait pas être écrit autrement. Vous avez trouvé la forme parfaite pour toucher le cœur.
Toucher le cœur, qu’est-ce que c’est ? Je suis la fille d’une maman abusée, et si j’applique la méthode comparative que vous utilisez souvent, son cas était moins « grave » que le vôtre, mais enfin, suffisamment pour que je sente dans ma chair, depuis l’enfance l’effet produit de ce qu’elle a vécu. Poursuivons votre réflexion, en abordant la question des dommages collatéraux. Pour résumer, ou essayer de faire comprendre en quelques mots de quoi il s’agit, ce que mon grand-père a fait subir à ma mère a eu des conséquences pour moi : j’ai hérité de ma mère une forme de « misandrie », ou crainte voire dégoût des hommes qui se manifestait par des stratégies d’évitement ou des crises d’angoisse à l’idée d’être approchée ou violentée. Le dégoût aussi, indéfinissable, enraciné, m’envahissait comme un raz de marée. J’étais bien consciente qu’il fallait que je transforme cet héritage, si je ne voulais pas moi-même projeter sur tout individu s’approchant de moi des représentations fausses, négatives et destructrices et aussi si je voulais laisser la porte ouverte à l’amour. Comment j’y suis parvenue, on peut le lire dans mon ouvrage De Terre et de chair, puisque c’est le travail de la terre, le modelage et plus précisément la sculpture d’après modèle vivant masculin qui m’a permis de faire bouger mes représentations en profondeur. Quand l’intégrité du corps a été touchée, la question de la confiance se pose inlassablement. Je n’ai pas été surprise de lire la façon dont votre corps vous échappe. « C’est un corps trop beau ou trop laid, irrésistible, en ce sens il est monstrueux, dégoûtant, c’est un corps et un visage qui ont des propriétés néfastes, qui attirent irrépressiblement mais qui n’attirent pas la contemplation ni l’admiration ou la tendresse mais le besoin de s’en saisir et, de toutes les manières possibles, les souiller, les détruire. » J’ai beaucoup réfléchi à cette question de la représentation et à la façon dont nos représentations intérieures altèrent la représentation extérieure. Je crois même avoir découvert la façon dont on peut, tous, modifier nos propres représentations par l’expérience du modelage, qui est travail sur le corps, grâce à la présence et à l’observation attentive du modèle. Je crois aussi qu’il est possible de réparer l’intégrité altérée du corps par cette pratique du modelage, à condition qu’elle soit réalisée dans un cadre sécurisant.
Pour mieux vous faire comprendre ce dont je parle, il faut que je vous relate une expérience de sculptrice. J’avais organisé un stage de yoga/sculpture avec une amie, professeur de yoga. Il s’agissait de réaliser une sculpture d’après un modèle femme et d’intérioriser la perception de son propre corps et de celui de l’autre par la pratique du yoga. Les trois journées alternaient entre posture de yoga, observation du corps de l’autre et sculpture, dans une ambiance de grande douceur. Cinq femmes se sont inscrites. Il a fallu leur apprendre à toucher l’argile, à la faire sienne, à observer le corps du modèle féminin, afin de le restituer. Or, quand on sculpte, invariablement, on sculpte d’abord son propre corps et surtout les représentations qu’on en a. Sans l’avoir cherché, ces femmes ont été confrontées à leur propre fondement, à des souffrances enfouies, à toutes sortes d’émotions qui ont jailli dans le processus de l’acte créateur. Au deuxième jour, une femme s’est mise à pleurer. Mon amie et moi l’avons accompagnée : elle était débordée par des douleurs enfouies, liées à son destin de femme et qui demandaient à s’exprimer. Et, quand le soir nous avons parlé de leur expérience, nous avons découvert que sur cinq femmes, quatre se sentaient bouleversées par le travail que le modelage opérait sur le regard qu’elles portaient sur le modèle et par ricochet sur leur propre corps. Ainsi, ce que j’avais écrit dans De Terre et de chair était vécu par d’autres. J’ai perçu l’énorme potentiel de guérison que contient le modelage tel que je le pratique, en l’envisageant comme une mise à nu et une façon de regarder en face ce qui est, sans peur. Le sculpteur voit bien au-delà du corps, cet extrait de mon ouvrage en témoigne : « L’alchimie qui s’opère est bestiale. Elle ressemble au conflit des pulsions qui veulent à tout prix exister. Aucune force en jeu ne cède du terrain, chaque partie intime de l’être exigeant le droit d’être captée et transférée. Il faut faire une place à chaque recoin de l’âme, aux secrets les plus enfouis, à ce que le corps a engrangé durant des années. Occulter ne serait-ce qu’une infime partie du tout, ce serait échouer. Je deviens un réceptacle de ce que le corps a à me dire, je laisse passer en moi, dans les mains, dans la terre, ce flux d’énergie qui charrie des années de désespoir, de désarroi, de résignation. Je prends tout sans penser aux conséquences. Il n’a jamais été question de se préserver, de choisir entre bonnes et mauvaises qualités. Le corps transpire. Il exsude par tous les pores ce que la conscience n’avouera jamais. Il donne sans répit tout ce qu’il est, tout ce dont j’ai besoin pour restituer un peu de vérité. Ce corps souffrant, je l’aime. Par sa seule faculté à souffrir sans le cacher. Il devient ma structure mentale. Je lui prête ma disposition d’esprit. Nous sommes des infirmes de la vie, nous défaisons un à un les nœuds de chaque tissu, lissant les plis que la colère a formé à force d’endurer coups et meurtrissures. » Et, vous lisant, Neige, je me suis demandée si ma vie me suffirait pour initier d’autres femmes à ce que j’ai découvert. Je le glisse ici, car le processus de guérison ne se trouve pas forcément là où on l’attend. Il est possible de modifier profondément ses représentations, de réinitialiser en quelque sorte la perception qu’on a de son propre corps et du corps de l’autre, d’apprendre à le regarder et à le chérir, d’apprendre à accoucher de soi-même, dans un acte de renaissance qui nous libère.
Je vous écris, Neige, parce que nous sommes tous responsables de ce qui vous est arrivé. Contrairement à la vieille dame que vous avez côtoyée durant toute votre enfance et qui continue à saluer le beau-père violeur parce qu’il ne lui a rien fait à elle, je me sens responsable de ce qui vous est arrivé, autrement dit, je ressens un instinct de protection fort à votre égard, à l’égard de tous les enfants potentiellement victimes, et non, le beau-père, je ne l’aurais pas salué, même s’il ne m’a rien fait. Vous écrivez que personne ne vous a protégée : « Ni mes instituteurs, ni les profs du collège, ni les éducateurs du centre social, ni le personnel des hôpitaux où j’ai séjourné pour mes problèmes de dos… », la liste est longue. Quand j’ai lu cela, j’ai sursauté. Lorsque j’ai commencé à enseigner le français, il y a 25 ans, j’avais à l’esprit qu’un jour peut-être, je découvrirais qu’un de mes élèves ferait partie des victimes de l’inceste ou de la pédophilie. Je m’y étais préparée, et même, me sentant particulièrement responsable, j’ai été très attentive aux signes, je m’attendais entre autres à avoir une révélation, même codée, dans une rédaction. Je peux vous dire que si c’était arrivé, je n’aurais pas beaucoup hésité avant d’agir. Et, ce qui m’étonne en vous lisant, c’est que, vu la fréquence à laquelle ça arrive, j’aurais dû y être confrontée. J’ai forcément eu au moins un élève abusé, et je ne l’ai pas vu. Pas su. Et même, dans chaque collège où les professeurs travaillent actuellement, il y a au moins un adolescent qui vit dans la terreur d’être violé. Dans les établissements scolaires, nous faisons des campagnes contre le harcèlement, puni par la loi depuis le 2 mars 2022, alors, je le propose : pourquoi ne pas faire une loi au sujet de l’inceste et du droit à l’enfant d’être protégé ?
Si l’on s’intéresse aux réactions des adultes face à votre situation, en particulier depuis le procès que vous avez voulu public, on ne peut qu’être stupéfait du déni qui persiste. Vous racontez que, lorsqu’il sort de prison, après avoir purgé ses cinq ans de peine, le beau-père violeur fait le chemin de Compostelle, où il rencontre une douce croyante qui a 20 ans de moins que lui, et donc le même âge que vous, – comprenons : ce qu’il vous a fait à vous, il aurait pu lui faire à elle quand elle était enfant – elle écoute son histoire et, séduite par son discours, choisit de l’aimer, de vivre avec lui et d’avoir quatre enfants avec lui. On sent dans ce passage que, sans tomber dans le pathos, vous suffoquez d’indignation. Dans une langue retenue mais claire, vous insistez : « Je fabule, là, mais je suis bien obligée. Franchement, moi, je ne vois pas comment on peut pardonner, ou même simplement en avoir envie, choisir un type qui a violé un enfant, même il y a dix ou quinze ou vingt ans, comme compagnon de vie, mais on va passer là-dessus puisque ce n’est pas de moi ni de vous qu’il s’agit mais de cette jeune femme qui, par charité envers cet homme dont elle est amoureuse, parvient à pardonner ceux qui l’ont offensée et à dépasser les obstacles que le Seigneur a mis sur son chemin pour qu’elle puisse prouver sa foi en Lui et en la Vie. » Je ne suis pas rebutée comme vous par la spiritualité pour laquelle vous ressentez « pitié » ou « mépris », mais ce que vous relatez là est spirituellement invraisemblable et retors. Un croyant pourrait vous répondre que ce n’est pas à cette jeune femme de pardonner, mais au mieux à Dieu. Et que, pour qu’elle pardonne, encore faudrait-il qu’il ait demandé pardon. Or, vous expliquez que de nombreux violeurs aspirent à être déculpabilisés sans trop avoir à en pâtir, comme si, soumis à des forces obscures, ils n’étaient pas vraiment responsables. Donc, le beau-père ne demande pas pardon, ni au moment du procès, ni après. Ni à vous, ni à la société. C’est très grave, ça, de lui pardonner, sans qu’il ait demandé pardon.
On pourrait imaginer un vrai cas de rédemption. Imaginons qu’il ait eu une prise de conscience de l’horreur absolue de ce qu’il a fait. Soit comme vous l’envisagez, il pourrait se suicider et là, on aurait la preuve qu’il a compris et regretté, soit, et c’est les cas infimes que la religion chrétienne envisage, il est dans le repentir et veut expier ses fautes. Mais encore faut-il qu’il y ait des signes, des preuves, des éléments tangibles qui montrent le chemin de la rédemption. Demander pardon ne suffirait sûrement pas, ou alors par une lettre qui montrerait son degré de repentir, ses larmes, son anéantissement. Il faudrait ensuite que chaque geste de sa vie répare : qu’il se consacre à ce fléau, qu’il s’adresse à la communauté des violeurs pour amener des prises de conscience, qu’il analyse les cheminements qui l’ont conduit à détruire, qu’il protège les enfants, en informant les familles, en donnant les signes annonciateurs. Au lieu de ça, il refait sa vie, a quatre enfants et accueille même dans sa bâtisse, du public et des jeunes. Donc, nous ne savons pas pourquoi au juste il ne recommencerait pas.
Ce personnage est un menteur. D’abord, il voudrait être un père pour vous, et voudrait s’imposer comme tel : « Il avait essayé d’exercer sa domination sur nous à travers le langage. Il voulait qu’on l’appelle papa », puis quand, lors de son procès, on lui dit la crainte qu’a la société qu’il agisse de même avec ses propres enfants, il est outré : jamais il ne pourrait faire ça à ses enfants. On est mal à l’aise, tout de même, avec cet individu libre d’aller et venir dans une maison où il y a des enfants, d’autant plus que s’il n’a pas « violé » votre petite sœur, elle dit tout de même avoir subi des attouchements, ce qui n’est pas rien. Adressons-nous à ses enfants, justement. La douce maman chrétienne, a-t-elle une seule fois envisagé ce qui se passerait en eux quand ils seraient en âge de comprendre que leur père a été un violeur d’enfant ? Comment va-t-elle leur expliquer le sens du pardon chrétien et la notion de bien et de mal ? Continuons. Quand ces enfants comprendront que des gens comme vous et moi auraient bien tout fait pour qu’ils soient protégés, accompagnés, mais que la société n’a absolument rien prévu pour ça et qu’à ce stade nous sommes simplement impuissantes, pourront-ils admettre qu’il ne nous restait que l’espoir qu’ils ne subiraient aucun sévices et l’espoir qu’ils sauraient se battre à leur tour pour faire évoluer les règles, les lois, afin qu’on sorte de ce cauchemar ? Leur mère savait mais a fait comme si c’était négligeable. Comment est-ce possible ?
Souvent, Neige, vous comparez votre souffrance à d’autres, et vous dites que ce que vous avez vécu n’est pas aussi grave. « Bien entendu, je sais qu’un viol sur une seule personne, même un enfant, même si c’est un viol abject et qu’il dure des années, est moins grave qu’un génocide », « J’ai appris à penser la violence dans les romans sur l’esclavage, la Shoah, la guerre d’Algérie. Je fais parfois des amalgames qu’il faudrait corriger ou nuancer, car un abus sexuel aussi traumatique qu’il soit ne peut pas être rapproché d’un crime contre l’humanité ». Selon moi, ce que vous avez vécu est aussi grave, c’est simplement la notion de mal individuel ou collectif qui est en jeu. Individuellement, c’est aussi grave d’être esclave, de voir sa famille mourir sous ses yeux, de sentir quotidiennement l’odeur des fours crématoires dans un camp de concentration, que d’être abusé. Je m’adresse à vous et à la société, bien sûr, mais nous ne pourrons agir que si nous sentons tous dans notre chair qu’il s’agit d’un crime. Il serait moins grave parce que commis dans l’ombre ? Moins grave parce qu’autorisé par le déni de tous ? Et si les enfants se mettaient à parler à des adultes qui les écoutent ? Et s’il existait des structures pour accompagner les mères (ou pères, parce que l’inverse existe aussi) afin que les enfants ne soient pas placés en famille d’accueil ? Si la société prenait en charge les conséquences, dès les premiers jours, afin que l’enfant n’ait pas à porter la responsabilité de l’éclatement de la cellule familiale ?
Si vous permettez de poursuivre sur les effets bénéfiques que produit votre récit par la réflexion qu’il engage, je voudrais m’attarder sur votre relation à votre fille. J’ai trouvé très belle cette façon que vous avez eu de lui parler et surtout le réflexe de la protéger, ou d’attirer son attention sur la nécessité de parler à un adulte de confiance au cas où elle serait confrontée à cette situation. On pourrait se dire : c’est la moindre des choses, mais en fait, cela ne va pas de soi. Ma propre mère a fait ses aveux quand je le lui ai demandé, puisqu’à 13 ans, je savais, sans que personne m’en ait délivré l’information, qu’il s’était passé quelque chose avec son père mais j’avais besoin de l’entendre. Elle a confirmé mes sordides intuitions. Et, par la suite, elle m’en a reparlé très et trop souvent. Elle n’a pas eu ce réflexe de me protéger, de protéger ma féminité, mon désir, mon corps. Elle a tenu à me montrer à quel point elle était victime, faisant naître en moi un immense besoin de la sauver. Un besoin qui s’est toujours cogné à son refus de se soigner ou au moins d’essayer. Et elle a laissé la peur s’immiscer dans mon corps de femme. Vous voyez, quand on tire les fils de ce traumatisme, on découvre que le mal s’étend loin, dans la vie de la victime et chez ses proches, mais là encore, puisque vous avez commencé à éclairer, continuons. Montrons que ce que vous faites, « Prendre ce taureau par les cornes et le faire tourner bourrique. Le saouler de paroles et de raisonnements jusqu’à ce qu’il craque, qu’il supplie que j’arrête et qu’il me laisse enfin en paix. » a considérablement réussi. Moi, je le vois. Je vois à quel point la guérison dépend de notre propre aptitude à prendre soin aussi des êtres qui nous sont chers, en leur donnant les clés pour se protéger. Et donc, j’écris aussi cette lettre pour votre fille, et pour tous les enfants qui sentent dans leur chair ce que leur maman ou papa a subi et qui eux aussi devront savoir quoi en faire…
« Il faudra que je me taise et que je laisse la parole à celles et ceux qui en ont plus besoin que moi. C’est vers ce silence que je dois tendre. C’est vers ce silence que ces mots sont tendus, comme des cordes au-dessus du vide, comme des arcs tendus au maximum afin que la flèche puisse partir le plus loin possible. » Vous m’avez touchée en plein cœur. Alors je tends mon arc afin d’envoyer quelques flèches à mon tour. Et voyez comme les cercles s’élargissent. Vous partez du cœur de l’expérience, et touchez non seulement les victimes, mais la famille, les amis, les professionnels. Moi, je ne pars pas du cœur, je pars de la sphère familiale, et ce que je souhaiterais produire, socialement, individuellement, c’est un désir puissant de guérison, de réparation. Par le même outil que sont pour vous les mots, mais aussi par l’expérience partagée du modelage, j’aimerais que les prises de conscience s’opèrent et avec elles un besoin de prendre soin. Voyez à quel point on a écarté le beau-père qui aimait tant dominer et gagner. Vous écrivez à propos d’une petite fille violée : « J’aimerais pouvoir écrire ce livre avec un peu plus de distance, être simplement quelqu’un qui a vu quelque chose, qui a été touché par les cercles concentriques des répercussions, quelqu’un à qui on fait promettre d’écrire un livre pour la venger ». Ce n’est pas la position qui vous est « attribuée sur l’échiquier », pour la raison simple que vous ne pouvez pas à vous seule remplir les rôles de tous, à chaque étage de la société. C’est aux mères à veiller et à sortir du déni, aux violeurs à se confesser dès la première tentation, aux frères, sœurs et amis à parler à des adultes de confiance, aux témoins à réagir sans délai, sans hésitation, à la police de protéger, à la loi de punir, plus sévèrement et strictement, aux instances sociales de recueillir les propos et d’organiser une vie immédiatement possible, aux amis de soutenir, aux voisins de cesser de saluer l’agresseur mais de sourire au contraire à la victime. « Tant qu’un enfant sur terre vivra cela, ce ne sera jamais fini, pour aucun d’entre nous. » Si tout le monde changeait un peu, on pourrait espérer une fin heureuse. Cela signifie que la fin heureuse ne dépend pas de vous, mais de nous.
Je l’ai dit, mais peut-être pas encore assez bien dit. Vous avez créé une arborescence, une capillarité possible. Vous écrivez « Tout mon caractère, c’est lui qui l’a fait. Le bon et le mauvais. Le génial et le terrible ». Vous parlez aussi de la façon dont votre psyché s’est élaborée, votre capacité à dissocier, votre difficulté à mémoriser, votre tolérance à la douleur. On ne peut nier que les engrammes laissés ont conditionné votre manière de percevoir. Mais, ce qu’il n’a pas fait, c’est d’entraver le moindrement votre aptitude à tenir haut non pas la bougie mais le flambeau qu’est votre conscience. Dès lors, grâce à Triste tigre, une opération de l’ordre de la magie s’opère, qui consiste à relier les consciences entre elles, à créer des ponts entre ce qui est éminemment vivant et édifiant. Est-ce l’œuvre du travail de vérité ? J’ose croire que nous serons suffisamment nombreux à regarder en face, à sentir l’aiguillon de l’élan vital pour travailler la matière noire, la dominer. Certains d’entre nous auront pour rôle d’aspirer le mal, de filtrer cette énergie et de nettoyer. Aux soignants de soigner.
Je ne crois donc pas qu’il a forgé votre caractère. Nous avons toute une vie pour forger notre caractère. Et, je ne crois pas non plus que nous sommes faites de la même glaise que lui. Il n’y a pas un bourreau en chacun de nous. Il y a des êtres qui préfèreraient mourir que d’avoir à dominer ou mutiler son semblable. Le combat avec les forces du mal, qu’elles soient de l’ordre de la domination ou du déni, existe bien. Et il ne faut pas craindre de le mener.
« Pourquoi est-ce que le témoignage serait nécessairement inférieur ? Est-ce la victime qui est inférieure ? Est-ce la vie qui est inférieure ? Est-ce l’honnêteté du récitant qui fait du récit un moindre texte ? » Le témoignage n’est pas nécessairement inférieur, l’ouvrage Mars de Fritz Zorn nous le montre. Pour mémoire, Fritz Zorn est atteint d’un cancer et comprend que son mal vient de l’éducation bourgeoise étouffante qu’il a reçue et qui l’a détruit au point de le condamner à mourir. Il écrit cet unique ouvrage pour témoigner. Il le publie en 1976 et meurt la même année, à 32 ans. C’est un immense livre, qui engage par ailleurs une réflexion sérieuse sur la corrélation entre la souffrance infligée et le corps malade. Est-ce une œuvre littéraire ? Je l’ignore. Le témoignage n’est pas nécessairement inférieur, mais dans votre cas, si l’on imaginait l’écriture d’une immense œuvre littéraire, il faudrait que le narrateur puisse se glisser dans la peau de chacun des personnages, inventer une situation où il comprend ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas dans la tête du beau-père, qu’il montre comment votre maman n'a pas réagi quand elle a vu que sa petite fille s’enfonçait une épingle dans le vagin, qu’il montre comment cette horrible répétition du viol a modifié votre perception du monde, jusqu’à la mémoire et la respiration. Il faudrait aussi restituer la place de chacun d’entre nous, dans l’histoire de l’enfant violé, ce qu’on a vu, pas vu, le fait que la société n’assume pas sa responsabilité ou pas assez. Et il faudrait aussi qu’il montre l’évolution de l’enfant, comment vous êtes devenue la femme que vous êtes, parce que contrairement à Fritz Zorn, vous n’avez pas dit votre dernier mot. Un roman qui rende compte de l’action du mal sur des décennies.
Tout cela, vous le dites, mais de façon rapide. Imaginez un peu l’énorme boulot que cela exigerait de restituer les points de vue, avec le langage qui va avec… J’ai un autre exemple d’œuvre littéraire très belle sur le sujet. Il s’agit D’un été autour du cou de Guy Goffette. C’est un jeune garçon qui est victime d’une femme, la Monette. C’est admirablement écrit et mis en scène mais l’histoire est plus simple, moins douloureuse que la vôtre, plus elliptique aussi. Et Guy Goffette était un poète, ce qui change la nature de son écriture. Je parie qu’un jour un écrivain y arrivera, grâce à ce que vous avez écrit. On évolue. On se lit, on écrit et peut-être que chaque livre gagne du terrain sur la difficulté de dire. Ainsi, lirons-nous un jour la grande œuvre littéraire du romancier qui vengera la petite fille violée.
Finalement, l’enjeu n’est pas de pardonner mais bien de venger : d’éprouver le sentiment libérateur que l’enfant a été réhabilité, que la justice a été faite pas seulement judiciairement, mais moralement ou plus précisément existentiellement, de rétablir l’équilibre, de changer la société et donc chacun de nous, au point de rendre la chose impossible. Peut-être même s’agit-il davantage d’une revanche que d’une vengeance : « Je crois moi aussi en l’existence de cette secrète bienveillance. Je la pratique moi-même quand cela m’est possible, comme une revanche contre le mal qui m’a été fait en silence. Et je sais que d’autres gens du peuple des ombres font la même chose, chacun et chacune dans le coin où il lui a été donné de vivre. »
Vos dernières pages sont magnifiques. Elles ont la beauté d’une mélopée. « C’est un monde où victime et bourreau sont réunies. Je crois que ce sont les mêmes ténèbres, ou presque les mêmes. C’est un monde où l’on ne peut ignorer le mal. Il est là, partout, il change la couleur et la saveur de toute chose. » Vous avez fait l’expérience inouïe de connaître la profondeur du mal, de la connaître aussi bien que votre bourreau l’a connue, mais, à l’inverse des violeurs qui semblent ne jamais emprunter le chemin du vrai repentir (et pour le coup, ce serait intéressant de lire le témoignage non pas de votre beau-père, mais de votre beau-père véritablement repentant et donc amendable, sans quoi nous lirions une de ces énièmes pseudo-justifications dont vous nous livrez la teneur), à l’inverse des violeurs qui, ne connaissant pas le repentir n’éclairent pas les ténèbres mais continuent à y vivre, en aménageant le territoire, vous avez touché le cœur des choses et vous avez nommé, expliqué chaque méandre de la bête monstrueuse. Le vainqueur n’est pas celui qui reste dans l’ombre mais celui qui éclaire. Vous nous avez donné les moyens non pas de comprendre mais d’identifier et de débusquer le tigre. Vous avez élagué, défriché le territoire où il se cachait. Il est là, terriblement nu sous nos yeux. Et il ne peut fuir, ce qui, je dois l’avouer, crée un certain sentiment de satisfaction.
Je dois terminer cette lettre, Neige, et vous remercier d’avoir repoussé les limites littéraires qu’impose un sujet tabou. J’espère que ce dialogue se poursuivra à travers d’autres œuvres et j’espère que chacune des personnes qui aurait frôlé cette insupportable réalité se sentira légitime pour prendre la parole et poursuivre le travail de compréhension que vous avez initié.
A la littérature,
A nos enfants sauvés,
A vous, Neige.
Valérie Rossignol