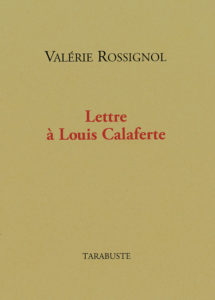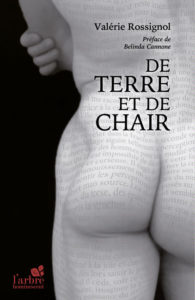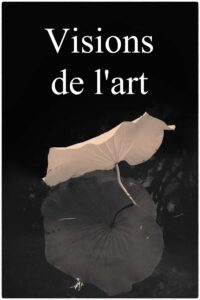Domecq, sur l'Ambiance littéraire française…
Ceci est un livret en 6 chapitres d'articles publiés entre 2021 et 2024.
Sur l'actualité de Sollers, Houellebecq, Genet, Kafka...
Par Jean-Philippe Domecq
-1-
Paru dans la revue Esprit, en novembre 2024
Ce que le surréalisme dit à notre époque
L’attention que suscite le centenaire du Manifeste du surréalisme montre que ce mouvement ne renvoie pas qu’à lui-même, ou au passé qu’il a traversé. Si son « magnétisme » opère encore, c’est que son exigence initiale de remise en cause et de passage au tamis de toutes les valeurs héritées résonne jusqu’à aujourd’hui.
novembre 2024
Qui eût cru, en 1924, que la parution d’un manifeste, comme il s’en commettait bien d’autres alors, serait célébrée cent ans après, à coups de rééditions et d’expositions si fidèles à la vivacité d’esprit initial, sans nostalgie ni embaumement du cadavre, fût-il « exquis1 » ? Plus encore, qui eût cru, ces dernières années, que ce centenaire rencontrerait une attention publique sans commune mesure avec le classique multiplicateur commémoratif ? Aujourd’hui, une déclaration d’intention aussi révoltée, aussi inventive et réfléchie, aussi intensément exigeante que le fut le Manifeste du surréalisme lancé par André Breton passerait moins qu’inaperçue, ne passerait pas du tout, elle ne passerait tout simplement pas la rampe de l’édition et encore moins celle de la presse. Et pourquoi ? Tout est dans ces mots d’intense exigence qui condensent l’origine mentale du surréalisme. On n’en voulait plus, d’exigence, dans l’Ambiance actuelle. Apparemment. Car voici que cette ambiante opinion culturelle, dont le groupe surréaliste n’aurait pas laissé tranquilles la vulgarité thématique, les simplismes intellectuels et les sirops d’audace, prend la boule d’énergie surréaliste en plein cœur, tel un soudain symptôme révélant un manque, une aspiration. Il faut dire que l’exigence qui propulsa loin l’aventure surréaliste n’était pas seulement poétique, éthique, politique, psychanalytique, elle était vitale. Qui vive ? demandait et répondait un de leurs tracts, façon revolver existentiel. C’est, somme toute et avant tout, la seule question qui vaille, si l’on veut faire un peu plus que, disons : survivre = sous-vivre. L’émotion qu’impose ce centenaire d’un mouvement culturel interroge notre présent plus que le passé, 2024 plus que 1924, en miroir face à nous aujourd’hui.
Une attention de rêve
Il vaudra d’ailleurs mieux ne plus l’oublier, en perspective « cavalière » dirait André Breton : l’histoire culturelle savante et commune aligne les œuvres qu’elle commente comme autant d’étapes qui seraient toutes significatives, toutes également intéressantes par conséquent ; ce faisant, elle en surévalue beaucoup et nivelle le tout. Non, à côté de l’histoire admise, relue certes et toujours nécessaire pour la continuité d’une civilisation, il y a une autre culture, d’autres nerfs d’œuvres, qui font un effet bien plus que savant et mémoriel. Ces œuvres donnent le désir de vivre l’infini que l’humain, vu d’ici comme de tout sauf lui, est seul à avoir inventé. « Il ne tient qu’à toi », nous disent-elles.
Mouvement dont on a eu le temps de mesurer les limites et l’énergie, le surréalisme est peu ou prou assimilé par la société. Au point d’être recyclé par la publicité et aplati par les médias qui, avec leur imparable logique broyeuse – dont les surréalistes auraient daubé sans craindre pour la « carrière » qui, aujourd’hui, fait libéralement tourner le réussisme littéraire français –, ressortent le qualificatif de « surréaliste » au moindre désordre d’assemblée. Mais, plus profondément, l’histoire du surréalisme, une bonne partie de l’opinion peu ou prou la connaît, connaît ses images frappées, ses appels d’air à la subversion des valeurs, à la liberté incessamment gagnable, à l’exploration des désirs quels qu’ils soient, aux infinies capacités de l’imagination et de la pensée, aux chambres obscures de l’inconscient – André Breton disait « vouloir donner la clé de ce couloir ».
On le constate à « l’exposition du centenaire » conçue par Didier Ottinger au centre Pompidou : les gens n’y viennent pas pour apprendre ; leur attention, informée, est sensible plus qu’historienne. Ce qui frappe au long de ces quatorze salles de labyrinthe tel qu’en composait le groupe surréaliste en ses expositions-événements, c’est qu’entre la turbulence des œuvres et de leurs variés supports, de la peinture de Giorgio De Chirico ou Max Ernst à l’écran de Luis Buñuel et Salvador Dalí, de La Poupée de Hans Bellmer à la non moins érotique, si on y regarde bien, Boule suspendue d’Alberto Giacometti, des apparitions de Toyen aux galbes sculptés de Hans Arp, le public se presse, murmure et se tait, fait attention aux œuvres et à l’attention d’autrui parce qu’elles imposent chacune leur cercle d’ondes. Une attention de rêve, à vrai dire. Le surréalisme ne renvoie pas qu’à lui-même et au passé qu’il a traversé : son magnétisme – un mot de son lexique mais qui explique en tout temps que des œuvres comptent pour nous plus que d’autres – nous rappelle que « ce qui, n’étant pas, est pourtant aussi intense que ce qui est », selon André Breton.
Avant l’avant-garde
Devant les tableaux de René Magritte, observez ce qui se passe entre les regardeurs, couple ou amis, le phénomène est automatique, ils confrontent leurs interprétations, et pour cause : on commence par découvrir l’image peinte, de facture directement déchiffrable chez Magritte, puis on avise le titre ; il semble n’y avoir « rien à voir », alors on revient à l’image, et ce n’est plus la même, alors que c’est la même. Exemple dans l’exposition, la toile intitulée La Durée poignardée : une locomotive sort à toute vapeur d’une cheminée d’appartement close, sur le marbre de laquelle une petite horloge et un bougeoir sont posés devant un miroir ; autour, parquet, lambris. On vient d’expérimenter qu’entre perception et pensée s’interpose le concept, toujours. « C’est la théorie qui décide de ce que nous pouvons observer » (Albert Einstein). Comme l’œuvre de Marcel Duchamp d’une autre façon, celle de Magritte fut conceptuelle dans les années 1930, bien avant qu’une avant-garde des années 1960 prenne le mot à la lettre et isole le concept comme s’il était indépendant du percept.
Et puis, au fil de l’exposition, on s’avise que les Rotoreliefs de Marcel Duchamp contenaient le futur art cinétique ; que Duchamp a ouvert la voie future au plasticien belge Marcel Broodthaers ; mais que son ready-made de 1913-19172 a été la caution d’aubaine des suiveurs un demi-siècle plus et trop tard. Que les photomontages de Man Ray ont démultiplié les potentialités du développement photographique. L’ombreuse chambre d’hôtel fantasmée par Dorothea Tanning, où le fauteuil, le lit et les murs sont gonflés d’un lin qui saille de gestes et fouilles qu’on soupçonne férocement intimes, contient déjà les impressionnantes installations de l’Américain Edward Kienholz, mais va tellement plus loin car moins gratuitement que tant d’installations qu’a multipliées, de 1970 à 1995, le quart de siècle qu’aura duré l’Art du Contemporain. Les collages de Max Ernst sont autrement productifs spatialement, mentalement, oniriquement que ceux de Picasso, qui démontre toujours qu’il et on « peut le faire » (et alors ? ce n’est pas qu’on fasse quelque chose de nouveau qui importe, du nouveau il y en a partout, mais ce que cela apporte, ouvre). Max Ernst, à ce titre, fut le grand expérimentateur du xxe siècle, avec ses frottages, cordages, décalcomanies, ses Jardins gobe-avions, ses forêts lunaires à l’image de L’Europe après la pluie. La gestuelle de l’action painting, les drippings de Jackson Pollock agrandissent all over les phosphènes griffés des espaces stellaires que déployait Roberto Matta et celui-ci ne s’est pas privé de le lui dire en riant bien de New York, qui le lui rendra. La peinture surréaliste est alors sortie de l’imagerie dont Salvador Dalí, si doué de sa main, a répandu les pitreries molles ; avec sa nouvelle génération d’après 1945, elle a trouvé l’automatisme mieux que l’écriture automatique, dont Breton eut le discernement de mesurer « l’infortune continue ».
Résultat, le surréalisme a inventé tous les nouveaux langages qu’ont ensuite perpétués les avant-gardes du xxe siècle : abstraction lyrique par l’automatisme en peinture, actions et happenings dès les spectacles à scandale dadaïstes, living theatre, frottage, fumage, intervention in situ et art mural, films expérimentaux, photographies médiumniques, environnements de salles et remises en cause des cadres d’exposition… Toutes ces ruptures furent mises en œuvre par le surréalisme de manière propositionnelle, créatrice et non théoriquement négatrice.
Si un mouvement culturel a pu à lui seul ouvrir et baliser tant de voies d’expression, révolutionner et dévoiler tant de territoires de l’inconscient, du désir et de la pensée, c’est qu’il a aboli les frontières non seulement entre les genres, comme cela avait commencé à se faire avant lui, mais entre les différentes voies d’expression. Peu importe que la poésie soit écrite ou peinte, photographiée ou filmée, qu’elle passe par l’objet ou la promenade, laquelle donnera ensuite la « dérive » situationniste : du moment qu’elle révèle.
Modèle intérieur et surréalité
« Révèle » : pourquoi et comment aujourd’hui, si la culture nous concerne directement par rapport à notre vie ? Le surréalisme autorise d’autant moins de nostalgie qu’il est né iconoclaste, de la radicale négation de toutes les valeurs et formes par Dada, mouvement tellement négateur d’ailleurs qu’il a d’emblée réussi à ne même pas être une avant-garde. Cela n’a pas empêché « l’apparition d’un poncif indiscutable », de l’aveu d’André Breton dès le Second Manifeste. On ne reconnaît que trop en effet l’image surréaliste conçue comme l’électrisation réciproque de deux réalités contradictoires, qui a systématisé la conception plus nuancée de Pierre Reverdy et accentué celle de Lautréamont (« Beau […] comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d’une machine à coudre et d’un parapluie » [Les Chants de Maldoror, VI, strophe 1, 1874]). Mais les quatre décennies du surréalisme (jusqu’à la mort de Breton en 1966 en tout cas) portent la propulsion au-delà, et peut-être bien avec actualité. Pourquoi ?
D’abord en raison de l’axe esthétique déterminé par Breton, le « modèle intérieur » : « L’erreur commise fut de penser que le modèle ne pouvait être pris que dans le monde extérieur […] Il est impossible en tout cas, dans l’état actuel de la pensée, alors surtout que le monde extérieur paraît de nature de plus en plus suspecte, de consentir à pareil sacrifice. » Notons au passage l’autorité intellectuelle de Breton : il fut l’un des premiers à avoir intégré les conséquences de « la critique freudienne des idées » (Second Manifeste, 1930) qui effectivement jeta le soupçon sur notre identité ; notons aussi qu’il n’est pas jusqu’à la littérature des parages du Nouveau Roman notamment, avec L’Ère du soupçon (1956) de Nathalie Sarraute, qui n’explorera les soubassements et délitements de notre façon de nous parler. Et ajoutons que la psychanalyse fut particulièrement productive et renouvelée en France, Jacques Lacan ayant côtoyé le groupe surréaliste et tiré son sujet de thèse de la paranoïa dont Salvador Dalí, lorsqu’il était jeune et non pitre de lui-même, avait développé une théorie « critique » qui impressionna Freud lorsque le surréaliste catalan lui rendit visite à Vienne. Breton, qui impressionna beaucoup moins Freud lors d’une semblable visite, conclut ainsi sa réflexion esthétique : « L’œuvre plastique, pour répondre à la nécessité de révision absolue des valeurs réelles sur laquelle aujourd’hui tous les esprits s’accordent, se référera donc à un modèle purement intérieur, ou ne sera pas » (Le Surréalisme et la peinture, 1928). Or l’axe est toujours vrai. Certes, l’art, tout au long de son histoire, prospecte selon un mouvement de balancier entre observation du monde extérieur et son observation intérieure ; mais ses meilleures découvertes se font toujours à la crête entre extériorité et intériorité.
L’intensité de la remise en cause, du passage au tamis de toutes les valeurs héritées. La voilà, l’intense exigence initiale.
Deuxième ressort d’actualité pérenne légué par le surréalisme : dans le prolongement direct du Premier Manifeste, de fin 1924 à janvier 1925, Breton écrit une Introduction au Discours sur le peu de réalité dont le titre condense ce qui restera son impératif : « Le procès de l’attitude réaliste demande à être instruit. » De la lutte promise contre la version univoque d’un réel prétendument unique, par quoi s’imposent toutes les aliénations, émergera la fameuse conception démultipliée de « la » réalité, la surréalité, « où la vie et la mort, le réel et l’imaginaire, le passé et le futur, le communicable et l’incommunicable, le haut et le bas cessent d’être perçus contradictoirement » (première annonce du Second Manifeste). Peut-on reprocher à Breton de poser cette question qui devrait nous être éternelle autant que quotidienne : « c’est la réalité même qui est en jeu » ? Or, aujourd’hui, on reste rêveur lorsqu’on entend énoncer cette « révision absolue des valeurs réelles sur laquelle aujourd’hui tous les esprits s’accordent »… Où l’on comprend pourquoi le surréalisme n’entendit pas être un mouvement littéraire de plus, mais une discipline d’éveil.
Au service de la révolution
Et c’est le troisième motif qui explique le rappel de tonicité que le surréalisme injecte à « notre » époque : l’intensité de la remise en cause, du passage au tamis de toutes les valeurs héritées. La voilà, l’intense exigence initiale. Cette exigence, douce à qui veut vivre, est violente à l’hystérie des modérés, elle leur est insupportable. Symptomatique à cet égard : que n’a-t-on entendu depuis des décennies, depuis les années 1980 au bas mot, sur l’auteur des Manifestes… Ils en avaient assez de celui en qui ils voyaient le terroriste intellectuel en mal de papauté littéraire, l’intransigeant – ce qu’il était effectivement – qui excluait ceux qui abandonnaient l’enjeu de « changer la vie », l’amour, le monde.
Il est vrai que le Second Manifeste aligne des pages d’anathèmes et de règlements de compte qu’en 1946, dans la réédition, Breton ne cache pas regretter : « à mes dépens, les jugements parfois hâtifs que j’y ai portés ». Mais quinze ans auparavant, il couronnait de comique ses excommunications en s’accusant… de quoi ? : « S’il est une accusation à laquelle je reconnais avoir longtemps donné prise, c’est assurément celle d’indulgence », suit l’une de ses notes fulminantes de trois pages où il se tance « d’avoir tardé à pratiquer cette hécatombe » contre « les essoufflés », « voyous de presse », « les viveurs, deux ou trois maquereaux de plume, un crétin », pour conclure d’un mot, en majuscules et paragraphe : « MERDE. » Sidérant. Mais quoi, cela fait rire et dissuaderait le laisser-aller de l’Ambiance qui noie le marché d’œuvres des médieux et fins-lourds que laissent dire les doux douteurs au motif « qu’on n’y peut rien » ; tout laisser dire « avec nuances », c’est étouffer la tolérance par l’indifférence, c’est mépriser a priori le peuple démocratique, se mépriser soi-même.
Au reste, hormis sur Robert Desnos, Antonin Artaud, Georges Bataille – exclu pour noirceur systématique et culte de la déchéance (ce qui n’était pas faux) –, etc., il faut reconnaître que Breton ne s’était pas trompé sur l’arrivisme débordant puis franquiste de Salvador Dalí, auquel il troussa l’anagramme « Avida Dollars », sur l’art mondain d’« un cocktail, des Cocteau » (c’est si vrai), sur Aragon dont la licence poétique sut avaler et cautionner le stalinisme toute sa vie, Éluard aussi peu regardant, etc. À vrai dire, tout est dans les quarante ans de vivacité intégrale, et qu’il fallut bien intégrer pour maintenir le cap de l’enjeu. « Je ne nie pas que se superpose pour moi une autre anxiété : comment soustraire au courant […] l’esquif que nous avions, à quelques-uns, construit de nos mains pour remonter ce courant même ? », s’explique-t-il en rééditant son brutal Second Manifeste en 1946. En vérité, sous l’ambiant courant existe la communauté des Quelques, qui délibère et rit, et c’est bien notre époque qui ne laisse pas publier leur manifeste.
Si Breton n’avait été qu’un surmoi, son autorité serait inadmissible et digne de la révolte dont le surréalisme a fait l’un de ses ressorts qu’aucune époque ne devrait oublier. Au lieu de l’hystérie modérée qui s’agace de son et toute exigence, on devrait peut-être méditer cette énigme dérangeante, dangereuse mais anthropologique, qu’il faut apparemment une autorité magique pour fédérer une aventure collective vers « l’or du temps ». Le mot « magie » encourt le flou et n’est là que pour pointer les logiques que la rationalité n’a pas encore su expliquer. En veut-on encore un signe, on n’a qu’à se souvenir qu’en pleine période où Breton n’était plus guère citable, lorsqu’il fut question de la vente de son bureau, fameux par ses présences de statuaire amérindienne, océanienne et de toiles métaphysiques, oniriques, une émotion est remontée jusqu’à l’État qui a préempté la vente.
L’autorité n’est pas le pouvoir en culture, elle est discernement prescient. Les lèvres molles ont tenté de reprocher à Breton d’avoir voulu mettre « le surréalisme au service de la révolution », titre d’une de leurs premières revues, comme s’il avait été « compagnon de route » du communisme comme le furent si longtemps tant d’intellectuels français, de Jean-Paul Sartre à André Malraux sans oublier Pablo Picasso. Faux : la lucidité de Breton fut si rapide à comprendre qu’elle resta une leçon pour les générations futures, notamment celle de 1968. Après avoir introduit Freud dans le débat intellectuel français, Breton n’a pas écarté Marx, et alors ? Au vu des souffrances sociales et de la brutalité économico-politique du capitalisme, « je pense qu’on ne s’étonnera pas de voir le surréalisme, chemin faisant, s’appliquer à autre chose qu’à la résolution d’un problème psychologique, si intéressant soit-il. […] J’estime que nous ne pouvons pas éviter de nous poser de la façon la plus brûlante la question du régime social sous lequel nous vivons », explique le Second Manifeste du surréalisme. Moins de dix ans après la révolution bolchevique de 1917, quelques matinées lui auront suffi à comprendre que le Parti lui demandant sans cesse à quoi devait servir la poésie, tout serait asservi, à partir de cette simple question qui n’était pas que littéraire, si toutefois les mots engagent l’être et les actes : « Au cours de trois interrogatoires de plusieurs heures, j’ai dû défendre le surréalisme de l’accusation puérile d’être dans son essence un mouvement politique d’orientation anti-communiste et contre-révolutionnaire. »
Ce mouvement, qui marquera tout un siècle, a été lancé par trente jeunes gens au sortir de ce qui n’était « que » la Première Guerre mondiale. Voilà ce qui causa leur radicale révolte à l’encontre d’une société et d’une culture qui avaient permis cette « décivilisation », à laquelle André Breton ne craindra pas d’opposer la « civilisation surréaliste ». Pas question de se contenter de créer un mouvement littéraire de plus. Du bord d’un compréhensible désespoir absolu, il tire ce défi et l’énergie surréaliste. Le choix de vivre, donc éventuellement de « préférer ne pas », ponctue tous les écrits de Breton, et cela devrait calmer les « modérés » : « Et pourtant je vis, j’ai découvert même que je tenais à la vie. Plus je me suis trouvé parfois de raisons d’en finir avec elle, plus je me suis surpris à admirer cette lame quelconque de parquet : c’était vraiment comme de la soie, de la soie qui eût été belle comme de l’eau. J’aimais cette lucide douleur, comme si tout le drame universel en fût alors passé par moi, que j’en eusse soudain valu la peine. Mais je l’aimais à la lueur, comment dire, de choses nouvelles qu’ainsi je n’avais encore jamais vues briller. »
- 1. André Breton, Manifestes du surréalisme, tirage spécial illustré, préface de Philippe Forest, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2024 (toutes les citations de ce texte se réfèrent à cette édition). Voir aussi l’exposition « Le surréalisme d’abord et toujours », commissariat de Didier Ottinger et Marie Sarré, au centre Pompidou jusqu’au 13 janvier 2025.
- 2. Sur les deux avènements du ready-made, voir leur centenaire happening : Jean-Philippe Domecq, Bref Happening mondial [en ligne], photographies de Nicolas Guilbert, suivi de L’Avènement du mondart par Jean Daniélou, Paris, Tituli, 2014, et Total Ready Made, sa version vidéo par Ralph Reiss (2013, en ligne sur YouTube).
-2-
De l’inutilité de mettre l’évidence sous les yeux des cultivés, le 1er septembre 2023
- Céline, dans Les Beaux Draps en 1941: « Pas un racisme de chicane, d’orgueil à vide, de ragots, mais un racisme d’exaltation, de perfection, de grandeur. Nous crevons d’être sans légende, sans mystère, sans grandeur. Nous périssons d’arrière-boutique. »
- Sollers : « Céline mérite une compassion infinie.»
Le plus affligeant, dans ces deux citations, n’est pas qu’elles ne sont pas cueillies au hasard, ou pour démonstration, tant on pourrait en tirer des kyrielles de même tonneau chez l’un et l’autre auteur ;
le plus accablant n’est pas que Céline soit manifestement ravi par sa saloperie d’abruti ;
le plus répugnant n’est pas l’abrutissement lettré perpétré par Sollers qui a eu tout le temps, lui, de mesurer les conséquences de l’antisémitisme de 1941;
le plus scabreux n’est pas que Céline en procès ait répété que ses diatribes enthousiastes pour l’élimination des Juifs « n’était que littérature » ; le plus tordu n’est pas que Sollers ait reproduit le même blanchiment littéraire en se trouvant « libre », forcément libre et suavement provocateur de rédimer un écrivain parce qu’il fut écrivain, méritant compassion en effet, lui qui indisposait l’écrivain Ernst Jünger et ses collègues de la Wehrmacht qu’il trouvait « trop mous », et cela Sollers le savait ;
le plus vrai et avéré n’est pas que Sollers ait pareillement encensé la dictature prolétarienne, puis maoïste, puis la papauté de Jean-Paul II, le libéralisme-ultra, etc – toutes les saloperies de son temps, si on regarde bien ;
le plus abject n’est pas que Sollers ait lancé « Mères, tremblez pour vos filles ! » pour célébrer la pédophilie de Gabriel Matzneff qui en assumait joyeusement la matière dans toute son œuvre, qui fut toujours promue par le journalisme culturel ; du même acabit, Maurice Sachs au moins avait l’écriture tordue par la mauvaise conscience d’être un tordu.
Non : le plus asphyxiant est qu’il y ait des cultivés qui voient du « moralisme » dans ce simple rappel de mémoire ; le plus d’époque est que celle-ci entende « moralisme » au premier mot d’inquiétude morale – mais, retour de refoulé, elle fait grand retour sur Camus ;
le plus fumeux est que les mêmes balaient « tout ça » - fièrement - au nom de la « liberté » d’en finir « avec les querelles idéologiques » ;
le plus gênant n’est pas que, même dans ses diatribes de salaud, Céline restait le grand styliste de ses romans, tout comme Rebatet hélas, mais qu’il y ait des cultivés aujourd’hui pour trouver quelque style dans « l’écrituuure » de Sollers tout en tressautements mondains et quelque profondeur dans sa pensée saturée de références culturelles et tout en allusions systématiquement interrompues pour faire sous-entendre ce qu’il ne saurait dire, et pour cause ;
le plus vain, dans ce que je viens d’aborder, est qu’il est vain de l’aborder ; être cultivé, on le sait, n’empêche pas.
On ne peut parler qu’à très peu, entre Quelques, de ce que peut bien être la littérature dont on ne doute pas lorsqu’on en lit d’excellente.
-3-

« Chaque narrateur des romans de Houellebecq exprime son dégoût de l’émancipation »
Dans une tribune au « Monde », l’écrivain Jean-Philippe Domecq s’interroge sur la pertinence de la décision du président de la République de remettre la Légion d’honneur à l’auteur de « Soumission », le 18 avril 2019
Tribune. Sauf à considérer qu’une récompense républicaine n’a plus de sens, on ne peut laisser sans discussion l’octroi de la Légion d’honneur à Michel Houellebecq. D’autant que, d’ordinaire, les cérémonies de décoration honorifique à l’Elysée sont collectives et que celle-ci sera entièrement dédiée à l’auteur de Sérotonine [Flammarion].
Emmanuel Macron tient à marquer le coup ; interrogeons donc l’incarnation et la signature culturelle qu’il donne ainsi à son mandat avec toute l’autorité symbolique de l’Etat. C’est le moment, car c’est le deuxième temps fort qu’il marque dans le champ de la littérature.
Le premier, c’était lorsqu’il était allé jusqu’à accorder les Invalides à Jean d’Ormesson pour ses funérailles, à l’égal d’André Malraux au Panthéon. Honorer la mémoire de Jean d’Ormesson était certes nécessaire, mais on pouvait rester dans les justes proportions d’un écrivain sympathiquement académique. Il fut pour le moins immodéré de convoquer à son propos les mânes des « grands auteurs » qui, par leurs innovations, poussèrent la langue française jusqu’à de nouveaux territoires psychiques et historiques.
Un des rares sursauts critiques devant le discours présidentiel, une des seules bouffées d’« esprit de finesse », dirait Pascal, fut la tribune d’André Markowicz que publia Le Monde, le 11 décembre 2017 : « Aux Invalides, c’était juste la vieille droite ».
Vulgarité nouvelle tendance
Aujourd’hui, l’impression culturelle du quinquennat se confirme, le diptyque se complète en symétrie inverse avec le « sulfureux » que d’aucuns persistent à trouver en l’auteur de Soumission [Flammarion, 2015]. On retrouve le classique contrepoint qui permet l’aménagement du territoire psychosocial, auquel ont toujours contribué la littérature de conversation et, dirait André Breton, celle de « l’après-boire ».
Pour montrer qu’on ne s’offusque de rien, on s’offre, comme alibi de modernité décontractée, la vulgarité nouvelle tendance. La vulgarité, oui, la teneur nouvelle qu’elle a prise dans la culture commence à faire l’objet d’études, puisqu’elle passe pour libératrice, par une sorte de grand « Désormais » enthousiaste. Il s’agit, à vrai dire, du lâcher-tout pulsionnel et d’opinion dont on s’inquiète par ailleurs sur le plan politique.
Est-il possible de faire entendre enfin, malgré le concert de louanges qui accueille la parution de chaque roman de Michel Houellebecq, qu’il y a un décalage, profond mais passé sous silence, entre la ferveur médiatique dont il bénéficie et l’appréciation critique que beaucoup de lecteurs ont de son œuvre ? Tout un lectorat qui n’a pas de leçon d’ouverture d’esprit à recevoir a fort bien perçu que chaque narrateur des romans de Houellebecq exprime son dégoût de l’émancipation.
Souvenons-nous : pourquoi et quand Céline a-t-il sorti son sinistre fonds de commerce politique ? Dès l’instant où Céline s’est confondu avec Bardamu, son narrateur. Ceux qui invoquent sans cesse la pertinente et nécessaire distinction entre narrateur et auteur pourraient s’aviser que, de roman en roman, le narrateur de Michel Houellebecq a la même attitude à l’encontre des conquêtes de la modernité européenne ; cela finit par faire des romans porte-voix, et porte-voix d’une idéologie nauséabonde. Evidemment, l’auteur est un malin, chaque fois il se dérobe derrière son narrateur et échappe aux mains qui le veulent bien. C’est qu’il les soulage, il leur signifie que tout est permis dans les opinions.
Misogynie constante
« Cette distinction vient récompenser un grand écrivain français reconnu comme tel », dit le communiqué de l’Elysée. Un minimum de culture et de connaissance historique permet pourtant de voir qu’il y eut toujours des succès massifs pour la littérature du « ça va mal », du « on a tout perdu ». Des titres comme Les Beaux Draps, de Céline, ou Les Décombres, de Lucien Rebatet, ont donné à qui les lisait le sentiment d’avoir tout compris et qu’« on se le disait bien ». Depuis les années 1930, ce tour d’opinion facile n’y va plus si direct ; on est passé du lyrisme paranoïaque à l’ironie perverse-narcissique.
Soumission de Houellebecq jouait sur la peur du « grand remplacement », mais sans le dire ouvertement : un musulman est élu président de la République en France, et voyez, ça ne se passe pas trop mal, finalement. De même, sur le plan des mœurs, on peut s’étonner que tant d’esprits progressistes ne soient pas choqués par la misogynie constante que les héros de Houellebecq ne se gênent pas pour exprimer.
« Glauquisme »
Et que dire du héros de Plateforme (Flammarion, 2001), qui dit à sa bien-aimée que le couple oriental où la femme fait tout et obéit au lit, « c’est pas mal, non » ? Qui n’a vu que ses descriptions du désir sont les mêmes lorsqu’il décrit le sexe tarifé et le sexe amoureux ? Cela pose un problème littéraire de langage qui ne fut pas trouvé. Et d’un mot, venons-en à cela, au fameux « style » houellebecquien. Michel Houellebecq a un incontestable ton, qui peut nous amuser, comme les saillies de comptoir, un temps, pas longtemps.
Le sociologisme illustratif de Michel Houellebecq fait plutôt horoscope de magazines.
Quant aux événements sociaux et mondiaux dont on nous dit qu’il les a prévus, c’est un fait que lorsqu’on se fonde sur le pessimisme systématique, l’actualité nous fait tomber juste deux fois par jour comme toute montre arrêtée. On en apprend beaucoup plus sur la France en ce moment dans les enquêtes et articles journalistiques ; à côté, le sociologisme illustratif de Michel Houellebecq fait plutôt horoscope de magazine.
On n’a pas lutté contre le roman idéologique, autrefois réaliste-socialiste ou psychologisant, pour retomber dans le même écueil aujourd’hui sous prétexte qu’il est actualisé par la Réaction. Freud voyait dans le relâchement pulsionnel le Malaise dans la civilisation, annonciateur de barbarie.
Un jour, on s’étonnera du succès d’un auteur qui aura joué sur la valeur uniment révélatrice du glauque. Au point qu’on peut appeler le mouvement littéraire pour lequel il a eu ses suiveurs : le « glauquisme ». Ce qui paraîtra neuf, ce n’est pas l’œuvre de Houellebecq, mais l’encensement dont elle fut l’objet ; ce qui est neuf, c’est ce symptôme nouveau qu’on peut nommer la culture contre la culture. Mieux vaut prévenir.
Jean-Philippe Domecq est romancier et essayiste. Il a notamment écrit « L’amie, la mort, le fils » (Thierry Marchaisse, 2018) et « Exercices autobiographiques » (La Bibliothèque, 2017).
-4-
« Ce qui restera de Michel Houellebecq n’est pas son œuvre, mais le fait qu’elle a été abondamment commentée »
La cause idéologique du romancier étant « enfin entendue » après ses déclarations sur les musulmans, l’essayiste Jean-Philippe Domecq regrette, dans une tribune au « Monde », que l’on cherche à préserver son réalisme sociologique à travers son étroite grille de description nihiliste.
Publié le 07 janvier 2023
Le nombre de lecteurs qui se mordent les doigts d’avoir cru que Michel Houellebecq était un écrivain important s’est encore accru après la parution de son dialogue avec Michel Onfray dans le supplément de la revue Front populaire, où tous deux partent en croisade pour l’Occident, émasculé par l’émancipation individuelle. Reste à sauver l’écrivain de l’idéologue, Céline servant encore de commode modèle.
De ce débat, le seul qui vaille si l’on aime la littérature qui nous révèle, quoi qu’elle ait à nous révéler, Le Monde a fait état : le 4 décembre, Jean Birnbaum recommande Anéantir, de Houellebecq, parmi les « meilleurs livres de l’année » ; le 16 décembre, Marc-Olivier Bherer analyse « la radicalisation d’un auteur à succès » et, huit jours plus tard, Michel Guerrin y revient dans sa chronique titrée « Ernaux et Houellebecq, par leur distance froide, en montrant sans démontrer, sont tout aussi dérangeants et précieux ».
Lire l’analyse de Marc-Olivier Bherer : Michel Houellebecq, la radicalisation à l’extrême droite d’un écrivain à succès
La cause idéologique du romancier étant désormais et enfin entendue, on préserve son réalisme sociologique, en se contentant de son étroite grille de description. Si elle fut « prophétique », comme on l’a beaucoup répété, elle le fut d’un tout-fout-le-camp généralisé qui a frayé la voie politique de la négation de l’autre. Rappelons à nos deux inquiets pour l’Occident que le mépris de l’autre fut la définition du péché qu’inaugura le Christ.
Nostalgie des oppressions autoritaires
Il est étonnant que l’on ait mis du temps à voir que le narrateur houellebecquien, toujours le même d’un roman à l’autre, constitue donc le porte-parole de son auteur. S’il ne faut pas confondre narrateur ou personnage et auteur, cela vaut pour celui-ci et pas seulement pour le lecteur. A l’inverse, ce qui fait la force trouble du M le Maudit (1931), de Fritz Lang, qui pressentit les prémices du nazisme, n’est pas ce torve personnage, mais sa mise en emboîtement visionnaire.
La littérature a pour fonction de « montrer sans démontrer ». Le problème est que ce pertinent critère ne marche pas, ici encore, et point n’était besoin que Houellebecq ait craché le morceau : sa vision sociologique, prétendument révélatrice de la noirceur du monde actuel, est sociologisante, car systématisée par son exécration de tout ce qui, dans nos démocraties, quoi qu’il en pense, nous libère des oppressions autoritaires dont il a la nostalgie, avec la violente veulerie du refoulé. Exemple, sa énième charge contre le « remplacement » musulman, qui indigne la Grande Mosquée de Paris : ce qui gêne Houellebecq et ses identiques narrateurs n’est jamais l’islamisme radical, et pour cause, puisque celui-ci s’oppose à nos libertés que Houellebecq voue à son ironie de barbecue.
Dans Soumission, la France élisait un président musulman et, voyez, disait le narrateur très auteur, ça ne se passe pas si mal… Les pervers ont cette séduction de repérer le miel qu’il vous faut pour avaler le fiel qu’ils vous refilent. Même fiel au miel dans son dernier roman, que l’on dit d’une veine « adoucie » ; c’est vrai que le héros houellebecquien ferait pleurer sur son chien ou sur la détresse de devoir mourir comme tout le monde. C’est la fonction du sentimentalisme, comme disait Dostoïevski de ce tordu de père Karamazov : « Il était méchant. Il était méchant et sentimental. »
Un autre pertinent repère d’évaluation est la formule gidienne que « c’est avec les beaux sentiments qu’on fait de la mauvaise littérature ». Eh bien, nous saurons désormais que c’est avec de bons critères que l’on prend lourdeur nouvelle pour novatrice. Une singularité de la période que subit la littérature actuelle est l’énergie mise à déployer l’intelligence d’analyse à défendre tels auteurs malgré leurs œuvres et idées. C’est le seul sujet dont on aurait dû traiter dès les premiers livres de Houellebecq. On y trouvait, en premier degré et illustration dérivée, les produits et tendances de société que nous décrit, en bien plus précis et intéressant, le bon journalisme.
Complexe de progressistes repentis
N’oublions pas, en toute lucidité critique à l’égard du formatage médiatique et journalistique, que nous sommes quotidiennement cultivés par l’hégélienne forme de prière qu’est la lecture du journal. A côté, la littérature illustrative a toujours plu parce que le lecteur y retrouve ce qu’il sait, ses modes et objets récents, sans le regard révélateur que donne le style (même en son degré zéro, complaisamment prêté à Houellebecq). Rappelons au moins que la différence entre les romans sans ou avec littérature est que celle-ci fait découvrir. Y compris ce qui est sous nos yeux, qui échappe aux descriptions projetées par nos préjugés et humeurs.
Ce qui restera de Michel Houellebecq n’est pas son œuvre mais le fait qu’elle a été abondamment commentée. Son succès est un des symptômes de ce qu’il faudra appeler la culture contre la culture. Jusqu’alors, dans l’histoire, des auteurs à grand succès, parce qu’ils étaient bien ou mal-pensants ou de sensibilité commode, satisfaisant par là le premier degré sociologique de l’opinion, détournaient celle-ci des auteurs qui décrivent l’époque et non la leur. Aujourd’hui, croyant éviter les dérives de l’esthétique de la rupture novatrice, la recension littéraire met les fins acquis de la nouvelle critique au service de l’épais, et notamment de cette école littéraire, le « glauquisme », où le lecteur reconnaîtra plus d’un auteur tendance (Yann Moix, Christine Angot, Régis Jauffret).
On a cru, par complexe de progressistes repentis et par méfiance à l’encontre du moralisme, que c’est en privilégiant le tordu et le rigolard retour aux idées primaires que se révèle le bon gros fond de l’humain. S’il suffisait d’être pessimiste pour être réaliste, la vie serait simpliste, et la littérature ennuyeuse. André Breton émit l’intuition que la création devait, quoi qu’elle découvre d’embarrassant, le transmuer dans le sens du « signe ascendant » ; ce serait le moment de renouveler l’intuition, d’autant que l’on ne peut reprocher au surréalisme de cultiver la fleur bleue, lui qui introduisit l’inconscient freudien en France. Eclairer nos pulsions et réactions nous cultive quand c’est sans nihilisme, ce moralisme à l’envers.
Jean-Philippe Domecq est essayiste. Il a notamment écrit « Qu’est-ce que la métaphysique fiction ? » (Serge Safran, 2017).
Jean-Philippe Domecq (Ecrivain)
-5-
« Le débondage médiatique sur Kafka révèle ce qui fait le charme de la littérature et pourquoi elle se survit »
Dans une tribune au « Monde », le romancier Jean-Philippe Domecq revient sur les polémiques ayant suivi la dernière édition de l’émission « La Grande Librairie », le 31 mai, au cours de laquelle l’œuvre-phare de l’écrivain Franz Kafka a été moquée.
Publié le 25 juin 2023 à 10h00
Le 31 mai, à « La Grande Librairie » [sur France 5], on a pu entendre, grâce aux auteurs que le présentateur [Augustin Trapenard] invita à y aller dans « l’irrévérence » et « le décalé », que La Métamorphose de Franz Kafka (1883-1924) était un texte « malaisant, où y’a jamais d’espoir, je suis consterné par ça » (Philippe Besson) ; « En gros c’est un mec qui a la flemme, il va pas au travail et se transforme en cafard. J’ai compris la métaphore à la deuxième ligne, donc faire deux cents pages… On nous prend pour des débiles », acheva Faïza Guène. Qui ne croyait pas si bien dire.
Bêtise et vulgarité, soit. Mais il y a plus intéressant que ça dans ce débondage médiatique, qui est très positif, en fait. Il révèle a contrario ce qui fait le charme de la littérature et pourquoi elle se survit, étrangement. Du même coup, il fait ressortir l’actuelle tendance que j’ai nommée « la Culture contre la culture » et qui explique qu’on a donné tant de place au « glauquisme » littéraire (Houellebecq et consorts) et au simplisme idéologique (Onfray, BHL, etc.).
Les premières protestations prirent l’attitude de la littérature offusquée : « Nos classiques ! »… Or, nos passions démocratiques se moquent bien de « nos classiques ». En vertu de la liberté individuelle, nous vivons désormais dans un vaste « J’ai bien le droit », qui confond égalité des droits et égalité d’intelligences. Intelligences !… Ce mot paraît arrogant ?
Nos rigolos d’aujourd’hui
Alors faisons un test, comparons avec une autre époque. Kafka en a subi d’autres, après-guerre : « Faut-il brûler Kafka ? » fut la polémique lancée par des intellectuels communistes dans la revue Action en 1946. Nos rigolos d’aujourd’hui diront-ils que c’était intelligent ? Chaque époque a sa bêtise datée, son miroir grossissant, grossier.
Le marxisme littéraire s’en prenait au « pessimisme » démobilisateur et « petit-bourgeois » de l’auteur du Procès. D’ailleurs, à Prague sous férule soviétique, jusque dans les années 1980, il fallait chercher par soi-même les lieux de Kafka, dont aujourd’hui on tire le portrait sur les tee-shirts et les menus touristiques.
Là, on commence à voir ce que la littérature a de fort, parce que dérangeante, parce que prospectrice de ce qui n’est pas formulé sans elle. Effectivement, l’œuvre de Kafka a tout dit des angoisses du XXe siècle, et d’avant et d’après : son individu lambda, simple initiale, « K », est pris dans le labyrinthe où nous naissons.
Voilà du « décalé », mais terrible, subtil, pas du tout à la gueulante, au contraire. Kafka aurait gentiment souri à « La Grande Librairie », s’excusant d’exister, lui qui avait mieux à faire, son « salut », disait-il, qu’une carrière littéraire, et qui sortait tout sourire de chez l’éditeur où il avait publié une nouvelle : « Il en a vendu onze exemplaires, j’en ai acheté dix, j’aimerais tellement savoir qui est le onzième ! »
Un humble parmi les humbles
Eh bien, c’est cela, le charme de Kafka, qui a suscité la deuxième vague de protestations après l’orgie d’ineptie médiatique. La spontanéité des réseaux sociaux a même été fort juste, défendant cet auteur qui fut un humble parmi les humbles. Lui qui notait : « Dans ton combat contre le monde, seconde le monde. » On est loin de la foire d’empoigne concurrentielle.
C’est inséparable, l’auteur et l’œuvre qui nous parlent intimement, dans le temps. C’est comme l’amour que Franz suscita en Milena Jesenska (et dont on peut lire les lettres détruites qu’a finement reconstituées Marie-Philippe Joncheray, dans J’avance dans votre labyrinthe. Lettres imaginaires à Franz Kafka, paru aux éditions Le Nouvel Attila) ; la notice nécrologique que Milena fut la seule à lui consacrer prouve qu’il n’y a pas plus intelligent que l’amour quand les mots le font. De même, l’aura que le philosophe et critique allemand Walter Benjamin (1892-1940) attribue aux œuvres d’art vaut pour la littérature : ce qui nous atteint, c’est le karma, le charme auratique qui émane de l’auteur incarné par son œuvre.
On peut penser, au vu de l’actualité, que c’en est fini des temps où l’esprit de finesse et des « quelques-uns » dont Victor Hugo disait qu’ils font l’avenir de la littérature, ou de la minorité qui, selon Marcel Proust, servit de première caisse de résonance aux audacieux quatuors de Beethoven. Mais, les hommes voulant vivre, on peut ou il faut parier qu’ils inventeront toujours, demain comme hier, ce charme qualitatif sans lequel la vie est lourde, lourde.
Jean-Philippe Domecq a publié sur ce sujet Qui a peur de la littérature ? (Mille et une nuits, 2002). Il est aussi l’auteur de L’Amie, la mort, le fils (Thierry Marchaisse, 2018).
Jean-Philippe Domecq (Romancier et essayiste)
-6-
Paru dans Esprit, novembre 2021
Jean Genet, une notoriété très française
Jean-Philippe Domecq
« A la France m’attache seul mon amour de la langue française, mais alors ! », note Jean Genet dans son Journal du Voleur. Tout est là, mais pas uniquement au sens où Genet le croit. D’une part, et il a raison, la « poésie » qu’il revendique dans ses romans et poèmes, fait de lui un des écrivains ayant tiré le meilleur parti de cette langue. Comme Céline et Proust qui ont fort bien lu Saint-Simon, Genet a l’ample liberté d’enveloppement, la souple scansion syncopée de contrepoints, et l’audace d’accoupler élégance et inavouable en fourrant sa phrase de pépites de crudité bien à lui, puisées dans la sexualité et dans l’univers des voleurs, des criminels, des traîtres qu’il admire plus que tous. Et cela nous amène à ce qu’il ne croit pas si bien dire lorsqu’il voue la France aux gémonies sauf pour sa littérature : il n’y a qu’en France qu’une telle œuvre pouvait être si vite célébrée. En dix ans, Cocteau et Sartre font de Genet la coqueluche littéraire de Paris, au point qu’André Malraux en 1966, et c’est une image de courage culturel, se retrouve en tant que ministre des Affaires culturelles à défendre la représentation théâtrale des Paravents face à la majorité parlementaire scandalisée par cette pièce qui conspue et conchie les soldats français en Algérie. L’intelligentsia battit des mains ; de même, Aragon et encore Sartre avaient vu dans Le Voyage au bout de la nuit un livre « communiste », comme n’a pas manqué d’en glousser Céline lorsqu’il devra répondre de ses pamphlets antisémites où son style peut certes sembler une autoparodie parce qu’il jubile idéologiquement mais c’est la même « musique » que dans ses romans. On peut aussi, sur le plan de la poétique stylisée de Genet, reconsidérer la place que lui a faite certaine tradition française du style qui rédimerait tout. Lui-même d’ailleurs en fut encombré et connut une crise morale, au point de brûler son travail en cours, après la parution en 1952 de l’essai de Jean Paul Sartre, Saint Genet, comédien et martyr. 700 pages et quel titre… On comprend certes que Sartre intégrait la trajectoire de Genet à sa problématique de la liberté. La liberté toutefois, tout dépend laquelle. Et tout dépend de la poétique si, et seulement si celle-ci se fonde sur une éthique fièrement répétée, comme le fait Genet en vertu de son raisonnement en symétrie inverse : « Abandonné par ma famille il me semblait déjà naturel d’aggraver cela par l’amour des garçons et cet amour par le vol, et le vol par le crime ou la complaisance au crime. Ainsi refusai-je décidément un monde qui m’avait refusé. » (Journal du Voleur) « Aggraver par l’amour des garçons », autrement dit l’homosexualité serait l’égal de ce par quoi il « l’aggrave », le vol ? Et celui-ci par le crime ?... Dommage, car, dès Notre Dame-des-Fleurs jusqu’à Querelle de Brest (qui donna lieu en 1982 à la superbe transposition cinématographique de Rainer Werner Fassbinder), Genet rend la sensualité homosexuelle sensible à quiconque même ne la partage pas. De même son art du portrait des « tantes » et des « gouapes » (son vocabulaire), ainsi l’apparition de « Divine » dans un café de Montmartre : « elle déposa la fraîcheur du scandale (…) et l’étonnante douceur d’un bruit de sandale sur la pierre du temple, elle fit se tourner les têtes qui devinrent légères tout à coup (des têtes folles), têtes des banquiers, commerçants, gigolos pour dames, garçons, gérant, colonels, épouvantails. Elle était vêtue ce soir-là d’une chemisette de soie champagne, d’un pantalon bleu volé à un matelot et de sandales de cuir. A l’un quelconque de ses doigts, mais plutôt à l’auriculaire, une pierre comme un ulcère la gangrenait. »
Mais Genet tombe logiquement dans l’épaisse bêtise inhérente au moralisme à l’envers. Les deux auteurs de la préface, Emmanuelle Lambert et Gilles Philippe, remarquable duo d’acuité littéraire, à qui il faut associer Albert Dichy pour cette édition « Pléiade », ne cachent pas jusqu’où cela a pu mener : « On pourra dire que c’est ici la base esthétique de Pompes Funèbres et que c’est n’y rien comprendre que de s’offusquer du pire : « L’officier allemand qui commanda le carnage d’Oradour a fait ce qu’il a pu – beaucoup – pour la poésie. » Sartre, qui ne cessa de revenir sur le lien que Genet établit entre mal et poésie, préféra ignorer le passage et s’en sortit à bon compte : tout serait faux chez Genet, et la question de la sincérité devrait être suspendue. »
La poésie est pourtant aussi têtue que les faits : ce que Genet appelle sa « sainteté » est un monde d’inversion pure et simpliste qui, contre la société « bourgeoise » et certes hypocrite, dresse la féodalité interlope et la hiérarchie légionnaire. Quant au vol, il n’aime rien tant que de voler les mendiants et les pauvres. Passons sur ses récurrentes extases pour la délation, et voyons la littérature comme source de connaissance quand elle nous apprend qu’il y a des gens qui, comme Genet, repèrent à l’avance dans la rue ceux qui ont « un regard de volé » et il en jouit et pas qu’une fois. Sartre n’a pas vu là une magistrale figure de ce qu’il nomme « le salaud » dans sa philosophie de la responsabilité. Mais, puisqu’il ne faudrait s’en tenir qu’à « la langue » et à la « petite musique », prenons les deux noyaux poétiques qui polarisent d’entrée le Journal du Voleur. L’un est fort, d’enjeu : « Les jeux érotiques découvrent un monde innommable que révèle le langage nocturne des amants. Un tel langage ne s’écrit pas. On le chuchote la nuit à l’oreille, d’une voix rauque. A l’aube on l’oublie. » Genet saura l’écrire. Mais, tout au long de son œuvre il veut à tout prix fleurir, fleurir, et cela donne, juste à côté : « Il existe un étroit rapport entre les fleurs et les bagnards. La fragilité, la délicatesse des premières sont de même nature que la brutale insensibilité des autres. » Eh bien non. Sans le vouloir Genet nous apprend qu’on peut parler de métaphore stupide, par inadéquation foncière et schématisme, surtout quand elle est filée, enfilée tant et plus au long d’une œuvre. Et phrase suivante, Genet, dans sa borne rageuse, sort involontairement sa conception du style : « Que j’aie à représenter un forçat – ou un criminel – je le parerai de tant de fleurs que lui-même disparaissant sous elles en deviendra une autre, géante, nouvelle. » « Disparaissant » ? Il ne peut mieux dire qu’il fait le beau pour dissimuler, au lieu que le style révèle quand il est fort, fin.
Jean Genet, Romans et poèmes, « La Pléiade », éditions Gallimard, 1648 pages, 65 € jusqu’au 30/09/2021.