Abattre l'ennemi de J. Branco, par G. Rivron
La France contre Macron : la vie contre la mort, loin de la politique
Note de Gaspard Rivron sur Abattre l’ennemi, de Juan Branco, paru en mars 2021 aux éditions Michel Lafon
Passons sur le style affecté, tantôt prophétique, tantôt franchement ridicule et qui, du reste, était déjà celui de Juan Branco dans ses précédents ouvrages. Passons sur les quelques fautes d’orthographe, aussi – à ce sujet, je crois l’exemplaire en ma possession issu d’un second tirage, puisque je n’ai relevé en tout et pour tout qu’une vingtaine de coquilles, et non la myriade annoncée.
Ce qui nous intéresse entre tout, dans cet essai, c’est le point de vue adopté par l’auteur pour critiquer le régime politique français en général et son avatar du moment, la Macronie. Si Branco a, avec son Crépuscule, dès 2018 tant fait trembler le pouvoir en place et les tenants des choses telles qu’elles sont, c’est parce qu’il s’est d’emblée positionné, non pas contre, mais au-dessus ou, pour mieux dire, en dehors. Son but n’est pas, suivant les règles du jeu, de remplacer les dominants actuels par d’autres moins corrompus, mais de faire cesser le jeu, en en révélant « l’inanité des mécanismes » [p. 20], étant donné que pour lui, la démocratie représentative n’est pas un outil neutre susceptible d’être utilisé à bon ou mauvais escient, mais au contraire un régime en soi maléfique, l’élection d’une seule personne pour en représenter des millions amenant à une dérive mégalomane : « L’héroïsation est l’expression d’une dysfonction de la société […] La consécration et la déchéance individuelles sont leur zénith : le nôtre se situe en l’altérité […] » [p. 29] De là apparaissent les thèmes majeurs du livre : 1. La nature de la lutte portée par Branco : ce n’est pas une lutte politique, mais une lutte métaphysique, menée au nom de valeurs et de principes spirituels. 2. Les erreurs des partis d’opposition, qui se trompent de combat et divisent, favorisant le règne des puissants. Les idiots sont toujours utiles. 3. Le soulèvement des Gilets Jaunes, qui a ouvert la voie à une révolution où le bien public s’imposera face aux intérêts privés.
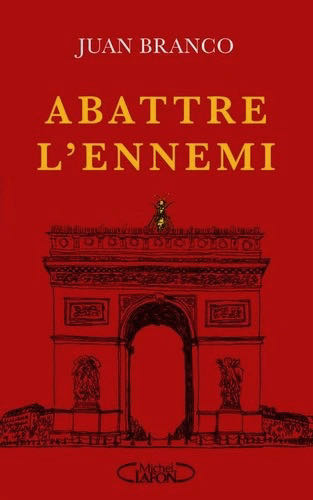
1. Une lutte en haut lieu
Les affidés du système n’ont qu’une crainte : « que l’on dise d’eux ce qu’ils sont, que l’on révèle ce qu’ils mirent des années à cacher ». [p. 18] Ainsi, c’est à l’essence de ses ennemis que Branco s’attaque, et non à leurs seuls actes : le simple fait de révéler ce qu’ils sont, et non ce qu’ils font, doit, indépendamment des conséquences matérielles de cette révélation, amoindrir leur influence néfaste. Ce faisant, sa dangerosité s’accroît. La clique des malfaisants, acculée, ne doit plus justifier de ses exactions, mais de son être même : c’est son existence qui est mise en danger. Il n’y a dès lors qu’un seul devoir pour achever de les abattre : « toujours à visage découvert, dire la vérité. » [p. 132] Rappelons-nous 1984, de George Orwell, où la reprogrammation mentale des opposants passe par l’assimilation de la célèbre formule : deux et deux font cinq. Si la logique elle-même est galvaudée et distordue, l’illusion est partout de mise, chacun devenant illusionniste et entretenant la mystification générale. Inversement, pour peu qu’une seule personne ose prétendre que deux et deux fassent quatre, c’est tout l’édifice des mensonges qui vacille et menace de s’effondrer. La vérité est le pire ennemi des totalitarismes. Ainsi Zinoviev pouvait-il écrire : « Et, dorénavant, le degré de développement d’une société, du point de vue de son humanité, sera défini par le degré de vérité toléré par cette société. »[1]
Leurs tours de passe-passe et leur faculté machiavélique pour la prestidigitation ont amené sous le contrôle absolu des puissants « l’espace du visible » [p. 79] : c’est pourquoi Branco porte la guerre dans l’espace de l’invisible. Il serait vain d’espérer les contrer dans le royaume où ils sont passés maîtres, il convient donc de dévoiler leur être même, afin que tous voient « l’absence de désir et de vie » [p. 118] qui les habite. Ce néant qui les caractérise se manifeste dans une avidité sexuelle et financière débridée, dont quelques scandales témoignent sporadiquement (incestes, exhibitions, détournements de fonds…). Toutefois, l’apparition au grand jour de ces malversations ne doit pas faire oublier que cette concupiscence vorace est systémique et non le fait de quelques dégénérés. Elle est due, dans les castes dirigeantes, à « une sourde éviction de ce que le monde a de plus précieux, le rapport à l’altérité » [p. 53], nos dirigeants s’étant eux-mêmes transformés en « consommateurs frénétiques » [p. 54] incapables d’amour et cherchant dès lors, comme compensation, la jouissance. Tous craignent la « mort sociale » et l’« attaque réputationnelle » car, « de l’intime à l’argent » [p. 131], ils ont toujours quelque chose de personnel à se reprocher. Loin de la banale critique politique, Branco met en exergue l’origine existentielle des méfaits perpétrés par les puissants.[2] Si donc, certaines affaires (Duhamel, Griveaux…) sont ponctuellement révélées, il ne s’agit certes pas d’exceptions mais de symptômes apparents ; et si politiciens et media paraissent condamner ces gens dont les méfaits sont mis au jour, ce n’est pas pour lutter contre la corruption : « Au contraire, il s’agit, en France, par la dénonciation et la mise à bas de tout accaparement trop grossièrement mis en œuvre, d’une part de renforcer l’acceptabilité de la corruption légale, et d’autre part d’en limiter le nombre de bénéficiaires à ceux qui ont le savoir-faire suffisant pour contourner l’épais appareil réglementaire et légal qui, censé la limiter, ne fait que la réguler. »[3] [pp. 221-222]
La hideur turpide de ces créatures apparaît parfois en d’autres occasions : quand on leur vole la vedette. Ainsi de Julian Assange qui, rendant par l’intermédiaire de Juan Branco un fier service à la France en révélant l’espionnage mené par les États-Unis, se voit agonir d’injures et de menaces, soupçonné de complotisme et de complots. Pourquoi ? Parce que, nous dit Branco, rendre un service à la France, c’est mettre ceux qui auraient dû veiller au bien du pays, et qui ne l’ont pas fait par intérêt personnel ou par incompétence, face à leur manquement.[4]
2. L’ineptie des partis d’opposition
Juan Branco est redouté de tous les candidats au pouvoir, y compris des partis d’opposition qui, en tant qu’ils participent au jeu de la société, préfèreraient bien sûr tout plutôt que de voir le jeu s’arrêter, puisque cela leur ôterait la possibilité de remporter la partie. Ils sont « part d’un système qui leur assure protection ». [p. 131] Les forces d’opposition sont « ontologiquement dépendantes de l’existant ». [p. 35] De même, Branco souligne la futilité et la contre-productivité des débats ineptes qui ont lieu, depuis quelques années maintenant, entre prétendus progressistes et dits conservateurs : « Avant d’être féministes ou antipatriarcales » [p. 63], les luttes devraient, selon lui, viser à s’émanciper de la consécration de la consommation effrénée. Car celui qui s’engage dans des luttes sociétales ne trouvera pour seul horizon d’émancipation que de « devenir eunuque ou victimaire, vindicatif ou violentant » [ibid.]. En d’autres termes, les luttes gauchistes et les réactions droitistes qu’elles déclenchent se trompent de combat, gaspillent les énergies et divisent : « gouvernants et militants, intellectuels et engagés, investis d’une cause qu’ils relient rarement à de plus amples totalités, semblent dépassés, réduits à trouver dans les questions des mœurs […] leurs terrains de lutte […], accroissant la division et accélérant notre effondrement. » [p. 157] Les questions sociétales ne sont que parties d’un tout qui échappe à beaucoup : le déracinement forcé dû à la mondialisation. Ce déracinement, explique Branco, s’est fait en deux étapes : d’abord les énergies fossiles, en facilitant et accélérant les déplacements, ont ébranlé notre rapport à l’espace et au temps ; puis les nouvelles technologies « ont unifié notre espèce en la plongeant dans le virtuel […], achevant de décentrer nos corps, les transformant en supports là où ils demeuraient le cœur de nos sociétés. » [p. 156] Si l’on comprend bien l’auteur, la mise à mal des liens interpersonnels, c’est-à-dire de l’amour, et leur remplacement par la consommation, plus que jamais nous ferait sentir le poids de notre condition humaine : celle-ci n’est plus adoucie par tout ce qu’un peuple façonne pour s’élever, la culture de l’esprit et de la terre, et que la mondialisation, en l’uniformisation qu’elle impose, détruit.
Or donc, pour Branco, c’est la mondialisation et la course effrénée à la consommation qui ont dévasté notre pays. Il s’ensuit qu’il faut réaffirmer l’indépendance de la nation, la souveraineté de son peuple. Les traditions ont été jetées bas parce qu’elles empêchaient « la pleine jouissance à laquelle nos dominants aspiraient » [p. 147]. Il n’est que de les restaurer. « Autonomie et souveraineté seront d’évidence et dès lors les mots les plus clairs que nous aurons à prononcer. » [p. 227] C’est ce que demandaient les Gilets Jaunes, eux qui étaient à la recherche « d’un pays, d’une patrie, d’une terre » [p. 121]. La terre est au centre de la réflexion de Branco, lui qui fait de la souveraineté « le socle de toute vie, un impérieux préalable à tout mouvement, garantissant à tout citoyen la possibilité de se voir, sur sa terre, protégé, et dès lors de pouvoir exercer sa liberté. » [p. 117] En invoquant ainsi la terre, Branco se place, rassembleur et réconciliateur, dans le sillage de tous les amoureux de la liberté, de quelque bord qu’ils soient, puisqu’aussi bien avant lui, réclamant la terre, se levaient l’anarchiste athée Georges Darien (« la patrie, c’est la terre de la patrie »[5]) autant que le catholique Charles Péguy (« Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle… »[6]). Des gens, enfin, issus de tous bords et dont l’un des rares points communs est qu’ils sont intelligents.[7]
Pour recouvrer la souveraineté perdue et gouverner la France, Branco suggère de nombreuses mesures. Elles présenteront à coup sûr beaucoup d’intérêt pour ceux qui s’intéressent à la politique et se proposent de remettre le pays sur pied ; nous ne nous y attarderons cependant pas ici, nous qui entendons surtout montrer la métaphysique du combat livré par Juan Branco aux puissances qui empoisonnent le pays. Notons toutefois que, selon lui, le renouement avec la souveraineté impose de « refuser toute ingérence » [p. 194] des impérialismes étrangers, ce qui implique de se retirer de la compétition mondiale, de collaborer avec des pays proches « fiers de leur identité » [p. 198], de demeurer au côté du peuple qui cherche « à préserver son intégrité » [ibid.]. Nécessaires sont encore la sortie de l’UE et la mise en place de communes aux ambitions « anarchisantes » [p. 162], autrement dit, tel que nous l’entendons, de communes mettant en œuvre une démocratie directe que ne permet pas l’échelle nationale – communes coordonnées par un État-nation rendu fluide et efficace par la suppression de nombreux intermédiaires administratifs.
3. La gloire des Gilets Jaunes
Or, cette reconquête de la souveraineté, ce refus de la mondialisation et cette compréhension instinctive du pourrissement où tombent inéluctablement tous ceux qui s’approchent du pouvoir, les Gilets Jaunes l’incarnèrent magnifiquement. « Ils sont le courage et la beauté. La grâce d’un pays par d’autres trahi se montre à leurs côtés. » [p. 23] Ce qui a de toute part été reproché aux Gilets Jaunes (par tout un tas d’imbéciles, dirons-nous), à savoir : de n’avoir pas de chef, est au contraire vu par Branco comme la force singulière de ce mouvement ; en cette particularité réside le pur renouvellement de ces réfractaires. Le but n’était pas de renverser le pouvoir, mais de vivre, tout simplement, c’est-à-dire de vivre sans le pouvoir. De considérer les règles mortifères et les contraintes virtuelles comme, de fait – mortifères et virtuelles. S’ils avaient pris le pouvoir, les dominés seraient devenus de nouveaux dominants puisque, étant humains, toutes bonnes qu’aient été leurs intentions originaires, ils auraient été corrompus par le pouvoir. C’était la grandeur de ce mouvement tel que Branco l’a théorisé, d’être anarchiste, sans contrôle, chacun étant (jusqu’à ce qu’à ce que s’étende la discorde semée par les médias et le pouvoir) capable de vivre avec les autres sans règle ni coercition imposée de l’extérieur. Renoncer au pouvoir : c’est pourquoi ce mouvement a terrifié les gouvernants, les a ulcérés et humiliés, « eux qui se surent épargnés et non vainqueurs » [p. 74]. La victoire définitive ne pourra d’ailleurs avoir lieu, selon Branco, que si l’on accepte unilatéralement ce fait : le pouvoir et ses alliés étant morts, il faut refuser le dialogue. Nous n’avons pas à parler à ces gens, et rien à négocier. « Cela consiste à dire que nous nous engageons à ne jamais nous laisser toucher par leur parole, mais au surplus à ne considérer à tout instant leurs mots que comme des armes produites afin de blesser, sans rapport à la vérité. » [p. 173]
Du fait de la déshumanisation qu’entraînait la mondialisation, tout était devenu remplaçable, interchangeable, les êtres humains eux-mêmes n’étant plus que les rouages numérotés d’une grande machine mise en branle par une minorité. L’enjeu des Gilets Jaunes a été la « possibilité de survivre en un monde où la singularité était devenue péché » [p. 27]. Il s’agissait pour eux d’affirmer leur volonté de vivre, leur aptitude à l’amour, face à ces gens qui, incapables d’empathie, s’étaient consacrés à la mort. « Nous nous étions trouvés portés par la légitimité qu’offre tout élan vital face à l’instinct de mort d’un pouvoir défait. » [p. 43] De telles affirmations nietzschéennes où la vie se justifie elle-même, se donne à elle-même, en tant que vie, le droit de vivre, se retrouvent ailleurs. On voit ainsi les ennemis condamnés en raison d’une « incapacité au don et à l’aimé » [p. 60], de même que Zarathoustra affirme la grande supériorité vitale de la « vertu qui donne »[8] sur celle qui prend. Mais les mots de Branco inversent aussi le nietzschéisme, promettant à la masse des faibles une victoire sur la tyrannie de quelques forts.
Appendice critique
Adressons, pour finir, quelques reproches à l’auteur. Premièrement, son attitude quant à la question du coronavirus. Résumons brièvement l’histoire de cette épidémie dans son rapport avec les Gilets Jaunes telle que Branco l’évoque : les Gilets Jaunes s’étaient levés pour manifester leur colère face à la captation des ressources publiques par quelques intérêts privés, captation menant à la dévastation du service public, dont les hôpitaux, qui ne seraient plus en capacité de soigner la population en cas d’épidémie. Or, l’épidémie a fini par arriver, confirmant les paroles des Gilets Jaunes : la désorganisation des hôpitaux a obligé les soignants à choisir leurs malades, incapables qu’ils étaient de s’occuper de tous. Les Gilets Jaunes, eux, durent arrêter de manifester, car la continuation des rassemblements eût augmenté le risque de propagation du virus, ce qui aurait porté atteinte à une partie de la population, notamment aux plus faibles, qu’ils avaient à cœur de préserver. Ils s’étaient levés contre le pouvoir pour protéger les faibles, et voilà qu’ils devaient laisser le pouvoir tranquille s’ils ne voulaient pas propager le virus parmi ces faibles, alors même que c’était la faute du pouvoir si l’état du pays était tel que l’épidémie ne pouvait être contrôlée : « Nous avions annoncé la révélation et celle-ci, intervenant, nous laissait sans capacité d’action. » [p. 35] Le reproche que fait donc Branco aux dirigeants, c’est, par leur impéritie et leurs détournements de biens publics, d’avoir exposé la population à la maladie et, alors même que cette maladie faisait rage, d’avoir pensé « avant tout au coup d’après, à ce que tout cela leur apporterait ». [p. 42] Lui qui se fait fort de mettre au jour les supercheries par lesquelles Emmanuel Macron et ses affidés assoient leur domination et de décortiquer les rouages par lesquels des acteurs privés captent les biens de l’État, il ne lui est pas venu à l’esprit d’accuser ses ennemis d’une malversation autrement plus grave : celle d’entretenir la peur au sujet du covid, d’instrumentaliser l’épidémie en exagérant sa dangerosité, de diffuser une propagande anxiogène qui décrédibilise les traitements et promeut des vaccins non testés qui ont l’heur de rapporter de l’argent aux acteurs privés ayant la mainmise sur les pouvoirs publics – ces acteurs privés que précisément il fustige. Il y a là pourtant matière à quelques scandales, et le fait que Raoult et l’hydroxychloroquine ne soient pas même cités une fois, en bien ou en mal, laisse à penser que Branco ne s’est tout bonnement pas suffisamment penché sur le sujet, pas assez pour en parler. Peut-être fera-ce l’objet de son prochain livre ?
Second reproche : le quitus accordé aux forces de l’ordre. Rappelons-nous qu’en définitive, la peur détermine, pour une grande part, l’action des hommes. Si les tyrans dominent, c’est que la masse craint, en se soulevant, de perdre le peu qu’elle a ou de mourir. Cette peur est inspirée par les gardes du tyran : ils ont la force physique et les armes. Le tyran n’a aucun pouvoir par lui-même ; celui qui peut ôter la vie, celui-là a le pouvoir. Il me paraît moralement faux et politiquement trompeur de prétendre que les policiers sont aussi des victimes parce que professionnellement contraints d’obéir aux ordres : seul celui qui peut ôter la vie donne des ordres. Les policiers décident de leur camp eux-mêmes. Qu’ils ne s’en rendent pas compte ne change rien à la donne : c’est à cause d’eux que rien ne change, parce qu’ils choisissent d’être les garants de l’ordre existant. Si l’ordre existant est inique et délétère, ils font en le protégeant un mauvais usage de leur force, en la mettant au service de politiciens et de milliardaires roués. Les roués profitent de la bêtise des forts, en cela Nietzsche avait vu juste. Mais je prétends que les plus coupables ne sont pas les roués, mais les forts qui les protègent – car ils ont la force physique et donc, le pouvoir.
G.R.
[1] Alexandre Zinoviev, Les Hauteurs béantes. Pour se convaincre de la ressemblance entre les analyses de Branco et celles de Zinoviev, et partant, de la similarité entre l’URSS d’alors et la France d’aujourd’hui, lire ma critique du livre du logicien russe. On constatera d’ailleurs que, comme Zinoviev, Branco avait tout pour devenir un bon petit soldat du système mais que, par une suite d’événements résultant eux-mêmes de ce système, il a fini par en devenir le pire ennemi, la Matrice ayant engendré elle-même sa propre négation. Ayons à cœur néanmoins de distinguer les particularités de ces deux totalitarismes : si la singularité de la Russie soviétique résidait dans la banalité du quotidien et la solitude des êtres, celle de notre France semble plutôt consister en une dilution complète du sujet, où les notions de solitude et d’intimité sont disparues sous l’argent et le divertissement.
[2] On se fera fort de relire, sur l’inaptitude des puissants à l’empathie, Le Bal des schizos, roman où Philip K. Dick donne à voir des individus qui, en un dédoublement psychique, deviennent de parfaits cartésiens postmodernes : esprits purs flottant loin de leurs émotions, ces gens considèrent tout corps, y compris le leur, comme un mécanisme à observer, disséquer, mettre au service de leurs ambitions rationalistes. Si tous nos actuels dirigeants ne sont sans doute pas nés affligés de cette maladie mentale, il est évident, comme l’a si bien illustré Bret Easton Ellis dans American Psycho, que celui qui accède au pouvoir et à l’argent, n’ayant plus aucune limite sociale qui l’empêche de faire ce qu’il veut, perd en même temps ses limites psychiques et devient donc psychopathe, s’il ne l’était pas déjà.
[3] Dans Les Hauteurs béantes, Zinoviev écrivait : « L’État lutte contre les défauts, mais il ne le fait pas au nom de quelque considération idéale et supérieure, mais uniquement dans la mesure où il est contraint de le faire et où il a quelque chose à y gagner. »
[4] On pourra tenir le même raisonnement pour comprendre pourquoi le Dr Raoult s’est vu du jour au lendemain crouler sous les accusations les plus sottes, méchantes et irrespectueuses, alors qu’il s’était contenté de proposer un remède pour une maladie qui effrayait tout le monde : mais ce n’était pas à lui d’être un héros, c’était aux dirigeants. Ils voulaient sauver le pays, non pour le bien de celui-ci, mais pour être reconnus comme sauveurs – quitte à le condamner plutôt que de le voir sauvé par d’autres. Comme l’écrivait Zinoviev dans l’ouvrage précité : « Ce qui existe, ce sont les intérêts de catégories de personnes bien précises qu’elles déguisent en intérêts d’État. En fait, ces gens n’ont absolument rien à fiche de l’État. Ils ne pensent qu’à eux. »
[5] Georges Darien, La Belle France
[6] Charles Péguy, Ève
[7] Rassembleur encore, Branco cite, en épigraphe, un extrait d’une épître de « Paul » : élider sa qualité de saint est un choix, sans doute, de ne pas rebuter les non chrétiens, puisque Branco lui-même est vraisemblablement chrétien. (voir le passage final de l’entretien accordé à Sud Radio le 4 avril 2021, où il dit avoir assisté à la messe des Rameaux)
[8] Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra



