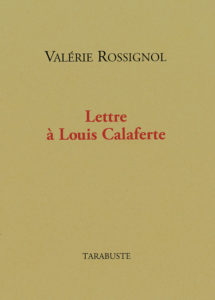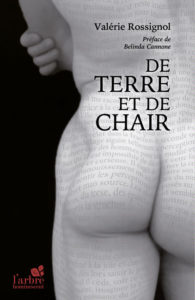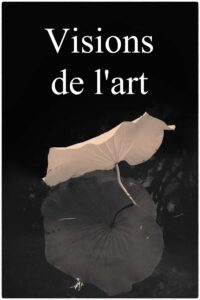Sarabande X de Corentin Durand
Sarabande X, une nouvelle mélancolie, par Valérie Rossignol, publié dans la revue Esprit en septembre 2025
Dans la continuité de son interrogation sur « l’aspiration littéraire » parue dans Esprit en septembre 2024, Valérie Rossignol propose une lecture du dernier roman de Corentin Durand, Sarabande X (Seuil 2025), comme un roman initiatique de la vie intérieure.
On la retrouve dans les accents profonds du fado, dans les accords doux et tendus d’un groupe comme Chokebore, dans les chants grégoriens. La mélancolie dit la souffrance, sans plainte et c’est parce qu’il la suit de près que la tension et la beauté de l’écriture de Corentin Durand nous mènent si loin. Es-tu « sourd au cri que peut nous arracher l’effroyable disproportion de ce qui est gagné à ce qui est perdu, de ce qui est accordé à ce qui est souffert», c’est là l’enjeu du livre, une citation d’André Breton, noté par le père, un réalisateur qui, n’ayant pu faire passer au public son film sur la guerre d’Indochine, se convertit au cinéma pornographique. Cette note-là est ainsi destinée au fils, Pierre, qui s’interrogera sur ce qui s’est passé dans la vie de son père. Cette phrase, c’est aussi celle qui structure le livre en deux parties, « ce qui est souffert» et « ce qui est accordé ». Nous aurions pourtant tort d’approcher le roman par le biais du sujet ou des thèmes : la guerre d’Indochine, le suicide, l’amour, l’échec professionnel d’un réalisateur... tant l’intérêt se cache dans une toute autre dimension.
Comme dans toute oeuvre géniale, le narrateur part à la conquête d’un territoire en partie inconnu dont les possibilités s’ouvrent de plus en plus. En faisant se rencontrer quatre personnages, Paul-Bernard un réalisateur, Angelo un chanteur, Linda son amante et Marguerite actrice de pornographie, l’écrivain laisse libre court à l’écriture de destinées fortes et singulières, inspirées de vies réelles. Il exploite les ressorts du roman afin de mettre en scène ces personnages qui deviennent amis, amants. On peut lire l’ouvrage comme un laboratoire d’expériences alchimiques qui livrent des parcours de vie difficiles mais cimentées par le besoin de s’élever. La citation de Breton serait alors l’écho du « signe ascendant », indissociable de toute aspiration.
Mais le roman dépasse largement ce statut narratif, à cause de la présence de Pierre, le fils de 28 ans qui ignore tout du passé de son père. Ainsi assimile-t-on le récit du point de vue de ce jeune homme qui semble écrire l’histoire, la sienne (les chapitres sont datés) qui se passe en 2017 (à Paris ou sur la côte Atlantique), celle de son père en 1952 (à Saïgon), en 1971 (à Paris), de son père et d’Angelo en 52, 71, 98, de Linda et Marguerite etc. Par cet éclatement narratif, le narrateur fait advenir la vérité. L’auteur se laisse guider par l’écriture pour découvrir et comprendre ses personnages, les ressorts de leurs destinées. Par cette liberté et cette forme d’aisance, on explore des enjeux humains profonds que seule la littérature peut restituer et englober. Comprendre, sans doute est- ce assimiler « ce qui est souffert». Et, ce qui est souffert, comme la forme passive l’indique, soumet chaque personnage à l’épreuve vertigineuse qu’est l’existence. Grâce à cette appropriation de vies qui ne sont pas la sienne, Corentin Durand façonne un univers éloigné des idéologies de notre époque. Aussi ne fatigue-t-il pas son lecteur à ressasser des sujets à la mode, des thématiques dont on est sûr qu’elle vont plaire dès lors qu’elles sont dans l’air du temps. Dans « Où est passée l’aspiration littéraire ? »[1], je montrais l’importance d’accorder une attention soutenue à la dimension poétique et spirituelle de la vie et donc de l’écriture. C’est ce que fait Corentin Durand en saisissant la beauté des paysages et la force des sensations : « En dirigeant son regard vers le continent, il ne vit que la maigre bande de fourrés d’un vert pâle qui bordait l’étendue vallonnée de sable blond. Il se sentit frissonner de chaud, de peur, puis se ressaisit et, auscultant le nouveau paysage, vit grandir en lui une joie confuse, animale. Il se tourna vers le soleil, exposa son corps de tout son long ainsi que Pierre l’avait fait, et ferma les yeux en écoutant dans le plein silence du monde inhabité le chant ancien de la chaleur. Il lui apparut, dans le souffle du vent sur le sable, d’étranges hallucinations sonores pareilles à des frictions profondes qui survenaient de sous la surface du monde ».
Aussi, lorsque j’ai lu ce fragment : « il poussait dans des poches ses poings fermés » où l’on entend le premier vers de « Ma Bohème », ai-je aperçu notre nouveau Rimbaud, fort de ses illuminations fraiches et saisissantes, puisqu’il ne recule jamais devant l’indicible. Le livre est traversé par des phrases de l’éveil, au pouvoir évocateur, accordant à l’attention, au sens très ancien de religio, sa puissance d’accueil. « Sur cette terre, et pour longtemps encore, il n’y aurait que la souffrance et le ciel - et la jeunesse pédalant dans le soir tombant car, près de l’image, le néant séjourne. »
L’attention n’est pas seulement une présence sensible au monde, elle est aussi une ouverture à la souffrance de son semblable. « Ce qui est souffert » ne l’est jamais seul car spontanément, Corentin Durand accorde une place centrale à la compassion. Ainsi, par exemple, quand le docteur Pierre Mottton prend sous sa protection un très jeune soldat qu’il baptisera Angelo, il est confronté pendant des semaines au mutisme du jeune homme traumatisé par la guerre. Alors le docteur joue de la musique au piano, s’arrêtant au même moment du morceau. Un jour, alors que les deux hommes ne se sont jamais parlé, le miracle se produit : « Puis, une gamme en dessous de là où l’homme tenait généralement ses mains, à l’accord où Pierre Motton s’était arrêté les jours précédents, Angelo poursuivit et termina le deuxième mouvement du concerto. Alors qu’il plaquait les accords, avec une irrégularité étrange, ne tenant aucun rythme durablement, il murmura quelques sons. Une brassée de syllabes et de respiration feutrées, retenues dans sa bouche même, qui semblaient, sur les accords, faire durer encore la résonance. À son habitude, Motton se tut. Derrière les verres des lunettes, une grosse larme coula sur la joue du médecin. Angelo, ahuri, perdu dans ce qu’il lui manquait de raison, continua à agiter ses doigts dans le vide. » La communion des esprits par la musique, l’élan de rédemption qu’offre la création montrent comment le traumatisme de la guerre d’Indochine peut être dépassé ou déplacé. C’est un exemple aussi de la façon dont se côtoient dans le livre la violence et la douceur, l’âpreté d’une situation politique et la posture que chacun choisit d’adopter.
Ainsi, quand nous lisons les pages concernant les scènes pornographiques, qui donnent naissance au film Sarabande X, sommes-nous agréablement surpris par le fait qu’il n’y a pas de rupture de tonalité, ni aucun tabou, jugement, désir de provoquer ou de transgresser. On est loin de la gratuité de certains romans français s’adonnant au « glauquisme », tant l’écriture reste éveillée, assoiffée de vérité et humblement humaine. Pourtant, les scènes où les hommes bandent et l’ actrice batifole sont bien montrées mais dans l’esprit des personnages, aucune surenchère n’est nécessaire. La scénographie pornographique est plutôt joyeuse et fait penser à la liberté drolatique de Pasolini dans Les Contes de Canterbury : « À l’intérieur des structures rigides de ses films pornographiques furetait ainsi une innocence bouffonne, adolescente, qui déridait les plus méthodiques des actrices, les plus mécaniques des partouzeurs. » C’est notamment par le biais de cet engouement sexuel qu’est montrée l’ambiance des années soixante dix, dont on a perdu l’insouciance et la liberté joyeuse.
Le point de mire du narrateur, ce qui donne la profondeur de son point de vue et l’unité narrative du roman est la vie intérieure. On en arrive à « ce qui est accordé ». Le regard moqueur de Pierre sur Minh, une femme agitée voire hystérique donne l’indice de ses attentes: « tout en elle se remplissait inlassablement de la vie qui n’était pas celle du dedans. » Il révèle un immense besoin de regarder la vie en face, sans se détourner. C’est l’état contemplatif dont les bonzes donnent l’exemple mais c’est aussi une exigence de vie qui conduit à se mettre à nu, à accepter sa propre vulnérabilité. « Que doit-on aux êtres qui se sont mis à nu devant nous? Tout peut-être semble lui répondre une petite voix, tout. » Au fil de la lecture, on se sent plongé dans une forme de sagesse, mystique très certainement, peut-être même religieuse. Pourtant, aucune leçon morale, aucun discours de vérité ne sont délivrés. Au contraire, fragilisés par la violence de ce qui est vécu, par la perte et la souffrance, les personnages cherchent une issue et Pierre finit par tomber dans une forme de maladie, la narcolepsie. Le voilà qui s’endort, à tout moment et en particulier quand les émotions l’envahissent. Le jeune homme devient le baromètre de l’insoutenable. La misère humaine est mesurée à l’aune de ses évanouissements. Ces disparitions coupent court à toute dérive hystérique, à toute démonstration folle de la douleur. Ainsi préserve-t-il une forme de calme, une sérénité que le bonze rencontré à la fin de son périple reconnaît, comme un signe, une élection : « Tu n’as pas sommeil, Pierre, tu as vaincu la mort, tu as appris la voie de la nage. Tu as cru que c’était une malédiction? Te voilà abreuvé de l’infini, te voilà assis dans l’oubli. »
Au-delà de la narration romanesque complexe, qui résout chaque noeud et accomplit les destinées, nous pouvons lire Sarabande X comme un roman initiatique de la vie intérieure. Sans doute y-a-t-il un vocabulaire commun à ceux qui se sentent suffisamment isolés pour avoir l’impression de vivre « au bord du monde ». Ce n’est pas un isolement qui retranche de la société des hommes, mais une conscience exacerbée qui place l’être en état de grâce, une aptitude qu’a la narrateur à voir la vie avec humilité, dans une sorte de rêvé éveillé. On retrouve ainsi l’état de surprise et d’émerveillement que convoque Breton. Et le voeu de Corentin Durand exprimé en fin d’ouvrage semble exaucé: « Roman, rêve, rivière : trois mots emmêlés. Trois idéogrammes que j’aimerais avoir tenu ici presque indissociables tant ils m’apparaissent reproduire le même geste : les romans sont des rivières qui rêvent et inversement. »
[1] https://esprit.presse.fr/actualites/valerie-rossignol/ou-est-passee-l-aspiration-litteraire-45485